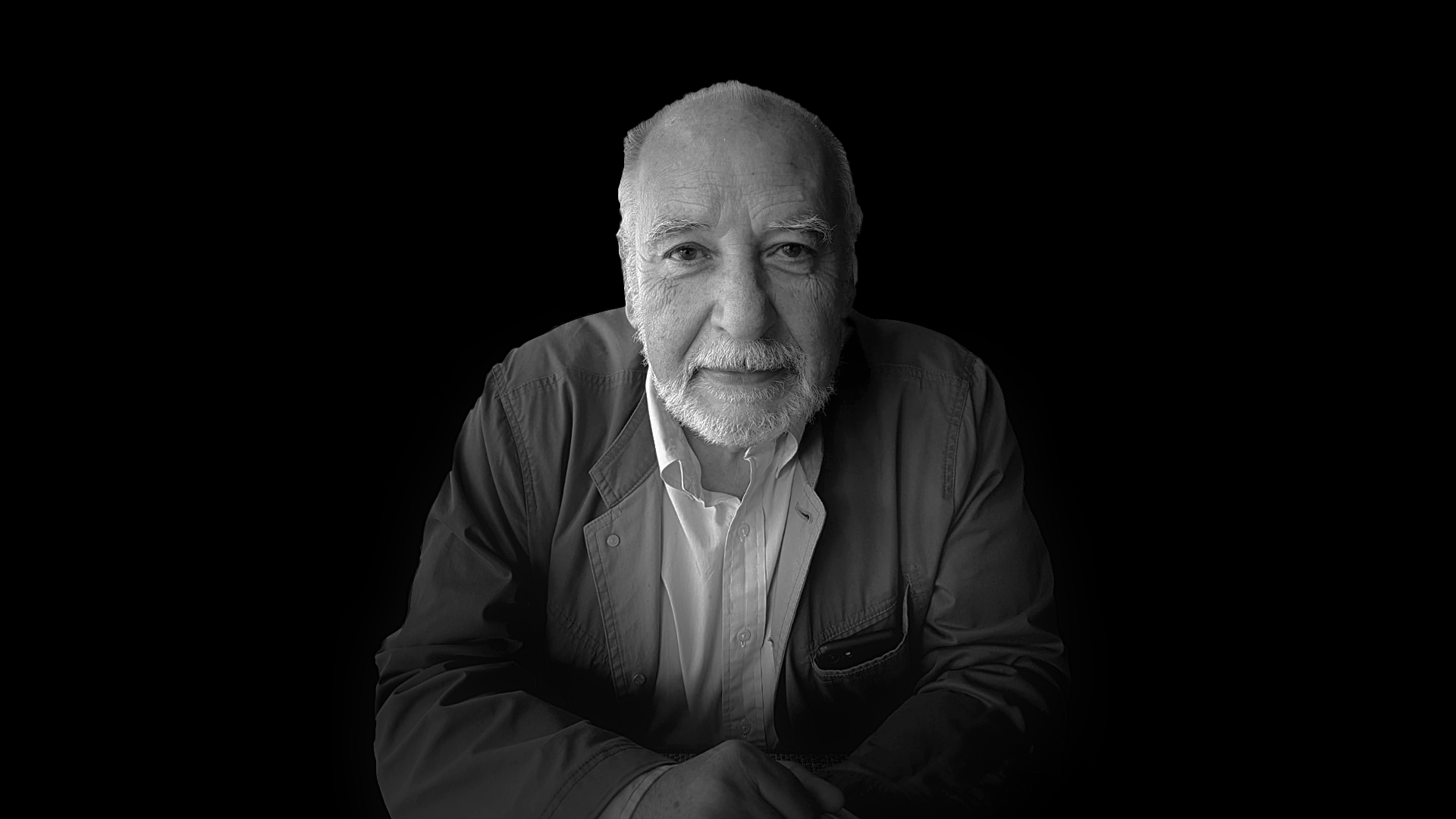Chaque retour au pays est un enchantement mêlé d’agacement. J’adore faire les valises de l’été. Peu d’habits, beaucoup de livres à lire pour la sélection du Prix Goncourt. Excédent de bagages. J’espère que ces romans, dont les auteurs et éditeurs espèrent tous décrocher le gros lot au mois de novembre, valent la peine que je les transporte de Paris à Tanger.
J’arrive tard le soir. L’aéroport de Tanger, habituellement tranquille, est plein d’agitation. Il va falloir l’agrandir. Trois vols d’Europe arrivent en même temps. La police des frontières fait son travail méticuleusement. Normal. On ne remplit plus les fiches d’entrée sur le territoire. Mais les vérifications prennent du temps. Les queues s’allongent. Certains débarquent de Bruxelles, d’autres d’Amsterdam et moi d’Orly. Les enfants sont fatigués. Ils pleurent. Les mères font ce qu’elles peuvent. Les pères regardent ailleurs. Eux, devant, elles, derrière. Elles suivent, surchargées comme d’habitude.
Je regarde le type devant moi. Coiffure à la mode. Sa touffe de cheveux noirs le fait ressembler à un oiseau dont je ne connais pas le nom. La femme, bébé dans les bras, a chaud. Il s’en fout.
Nous sommes nombreux à attendre les bagages. Quelqu’un dit «ah, ils commencent par les Hollandais!». Je ne sais pas comment il a reconnu ça.
Il y a les valises et puis les fameux cartons ficelés de tous les côtés.
Je pense aux romans qui dorment dans ma valise. Je pense aux personnages qui se sentent serrés comme dans une boîte de sardines. Certains aimeraient s’échapper et s’en aller découvrir le Maroc dont ils n’ont jamais entendu parler à part dans les livres écrits par des auteurs comme Yasmine Chami, qui publie à la rentrée de septembre un nouveau roman, «Casablanca Circus», ou Rachid Benzine, qui évoque la mémoire de son père à travers des cassettes audio laissées par celui-ci.
Mes bagages sont récupérés. Un vieux monsieur, porteur de son métier, les met sur le chariot. Je l’aide parce qu’il n’a plus la force de travailler. Il me parle de son fils qui fait des études de droit. Il lui cherche un emploi. Je le rassure en lui disant que le pays a besoin de sa jeunesse.
J’arrive à la maison et je tombe de sommeil. En fait, je suis trop fatigué pour dormir. Je me lève et prends au hasard un roman dans la valise. «Panorama». Un roman d’anticipation de Lilia Hassaine, jeune écrivaine d’origine algérienne. Je me mets à lire, je suis pris par l’histoire d’une société où tout est transparent. Tout le monde sait ce qui se passe chez les autres. On est en 2050. L’intelligence artificielle est à l’œuvre. Une famille disparaît et Hélène, l’héroïne, est chargée de faire l’enquête. J’arrête là et je m’endors en pensant à cette femme, frêle, belle, talentueuse.
Tôt le matin, je sors prendre mon petit déjeuner. La ville est déserte. Tout est fermé. Ville fantôme. Un décor de cinéma pour film de science-fiction sur la fin du monde. Non, c’est le troisième jour de l’Aïd. Ce sont les grandes vacances. Aucun café n’est ouvert. Le concierge, qui aurait pu me renseigner, est parti manger le mouton à Jbilat (village aux environs de Tanger). Il ne sera de retour qu’après la fin du mouton.
J’avais oublié cette fête que je n’aimais pas quand j’étais enfant. Le premier jour, on mangeait mal. La viande trop fraîche n’étant pas prête à être cuisinée. Alors on se contentait des abats, des brochettes de boulfaf, etc. J’aimais ce nom. D’où vient-il? J’enlevais le gras et j’avalais les morceaux de foie.
Ces souvenirs s’évaporent avec le temps et les voyages.
Les artisans ont arrêté le travail. A la maison il fait chaud. La climatisation est en panne. Il faut attendre la fin du mouton. Pas de plombier non plus. Finalement, on s’y fait et on attend avec sagesse et humour.
La télé a besoin de se connecter. Faut faire une manipulation. Je n’y arrive pas; je n’insiste pas. Ça tombe bien. Aucune envie de regarder les informations sur les émeutes en France. Je suis chez moi, au Maroc, et je me sens très bien.
Une image vient de surgir dans ma mémoire: durant la marche blanche avec la mère de Nahel en avant, un drapeau algérien flotte au-dessus de la foule. Nous ne sommes pas dans une compétition sportive, ni en Algérie.
Ce drapeau est le signe d’un malaise et d’une incompatibilité: les enfants des immigrés ne sont pas des immigrés. Nés en France, ce sont des citoyens français dont les parents sont venus d’Algérie ou du Maroc. Pourquoi exhiber le drapeau algérien dans une marche pacifique contre la violence policière?
On aura beau l’écrire et le dire, la mémoire franco-algérienne est meurtrie à jamais et la junte au pouvoir l’exploite en permanence, ce que Macron a qualifié de «rente mémorielle».
Il vaut mieux oublier ce «dossier» et aller marcher à la forêt de la Vieille montagne ou sur la plage au Cap Spartel.
L’air du pays me fait un grand bien. Pour le moment, du plus beau pays du monde, je ne vois que les qualités malgré la cherté de la vie. Tout augmente et c’est indécent. Enfin, je dis un grand merci aux Lionceaux de l’Atlas qui nous ont donné une belle victoire.