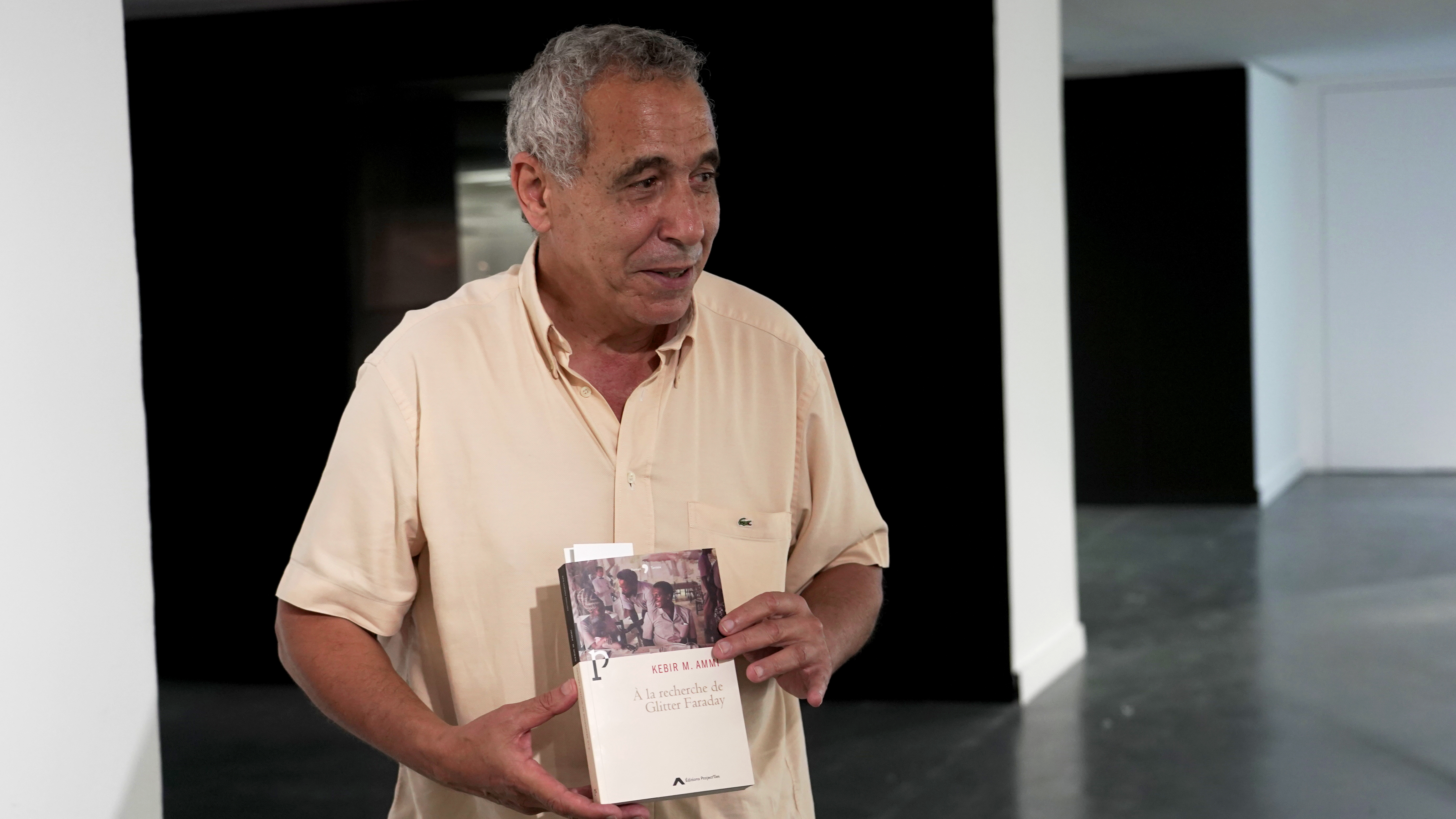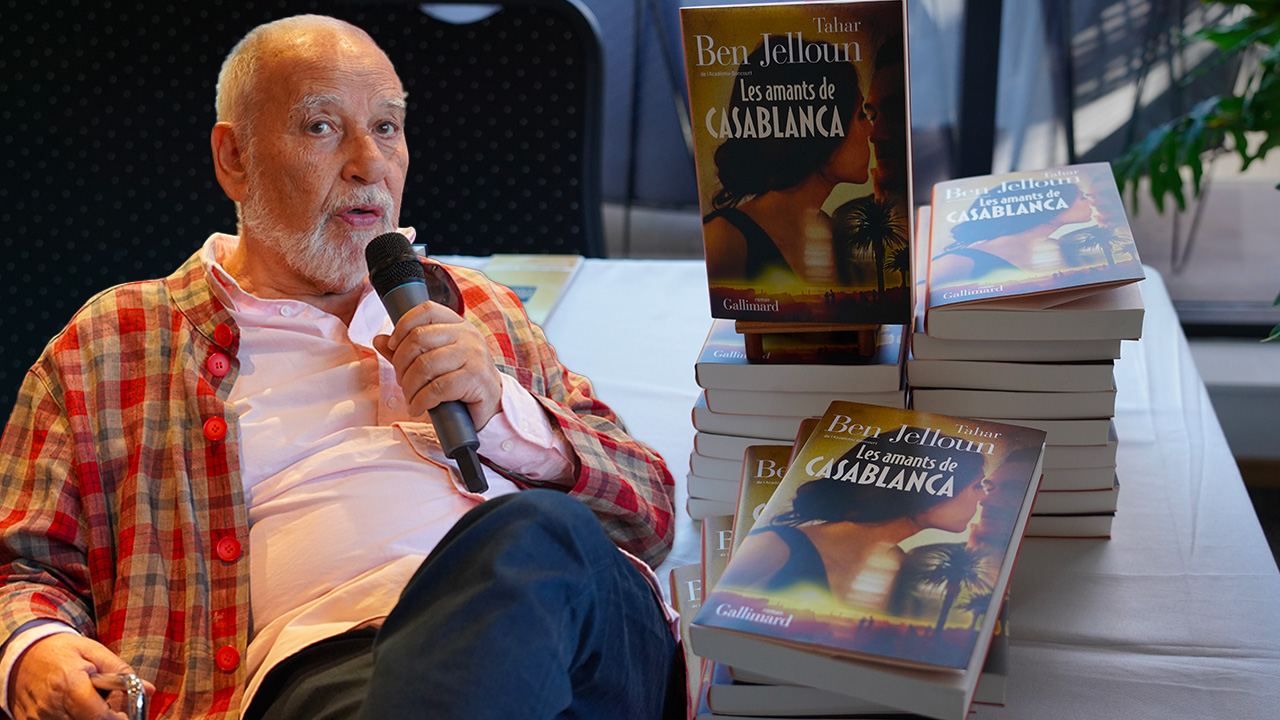Cette insoutenable gravité de la mort vient de frapper un grand écrivain, un homme qui aura marqué le siècle et la littérature universelle. Voici encore un grand que le jury du Prix Nobel de littérature a raté. Mais Kundera n’avait que faire d’une reconnaissance internationale de ce type, car il avait obtenu de son vivant un accueil public exceptionnel et ce dans quasiment tous les pays du monde.
Lui qui disait que «nous avons tous besoin d’être regardés», voulait être un «écrivain invisible». Il regrettait combien «l’intimité n’est plus respectée, envahie par l’érotisme».
Écrivain tchèque, réfugié en France après que l’Union soviétique a envahi son pays en 1968, il a été reçu dans ce pays avec générosité et bienveillance. Il s’est mis alors à écrire directement en français. Là, les opinions divergent. Ses lecteurs préférèrent ses romans tchèques, dont le plus célèbre reste «L’insoutenable légèreté de l’être». Moi, j’aime «La plaisanterie», un de ses premiers romans qui a traité les malheurs causés par le régime totalitaire avec humour, un humour noir et efficace.
Mais chaque nouveau roman de Kundera était un événement. Il fréquentait rarement les plateaux de télévision en dehors de l’émission culte «Apostrophes».
Toute son œuvre témoigne sur la condition humaine tiraillée entre le désir de liberté et la lutte pour l’atteindre. Ses livres sont construits comme une œuvre musicale (lui-même était pianiste, comme son père), qui n’oublie pas la dérision et le rire.
En 1961, il écrit «La plaisanterie», un roman, disait-il «inspiré par l’histoire d’une jeune ouvrière arrêtée parce qu’elle volait des fleurs dans un cimetière pour les offrir à l’homme qu’elle aimait».
Dans le roman, les fleurs sont remplacées par une carte postale où Ludvik écrit «Vive Trotsky». Ce malheureux plaisantin sera arrêté et écroué. On ne plaisante pas avec l’idéologie communiste. Les livres de Kundera seront retirés des bibliothèques et lui sera renvoyé de l’école du cinéma de Prague où il enseignait.
Son exil en France fut bénéfique. Mais tout exil est une déchirure. Ces dernières années, Milan ne parlait presque plus le français, mais seulement sa langue maternelle, le tchèque.
«La valse aux adieux» est un roman de rupture. Rupture avec une patrie que le système soviétique avait stérilisée, avait dominée au point de l’écraser et de lui retirer son âme. Ce fut le roman des adieux de Kundera à la Tchécoslovaquie qui l’avait déchu de sa nationalité.
En France, ses amis (Gallimard, Aragon et son traducteur) lui trouvèrent un poste d’enseignant dans la ville de Rennes. On raconte que quelqu’un lui aurait dit: «Rennes? C’est moche et c’est vide». «Alors, c’est pour nous», aurait-il répondu. Avec sa femme Vera, ils y resteront quatre ans. Ils reviennent ensuite à Paris, où lui enseignera la littérature de l’Europe centrale (Musil, Milosz, Kafka…).
En 1986, il publie «L’art du roman», un essai qui servira de base pour des débats infinis sur la littérature, l’engagement, les valeurs et l’esprit de reconquête de la liberté.
Parmi ses textes écrits en français figure «L’ignorance», un récit profond sur le fait qu’on ne retrouve jamais ce qu’on a perdu. Il considère que sa patrie ne sera jamais ce qu’il avait connu d’elle. L’ignorance de ce que nous sommes, et l’illusion que les souvenirs seraient de bons compagnons de vieillesse.
Quelqu’un disait ce matin sur une radio française que sa véritable patrie était Vera, sa femme, l’amour de sa vie. On ne voyait jamais Milan sans Vera. Ces dernières années, c’est elle qui répondait au téléphone. Aujourd’hui, Véra, dévastée par une si terrible disparition, va devoir vivre sans la moitié de son âme, de son corps, de sa vie.
Les grands s’en vont et ils sont grands parce qu’ils nous ont laissé une œuvre. Lorsque les éditions Gallimard décidèrent de publier cette œuvre du vivant de Milan dans la prestigieuse collection La Pléiade, il a refusé toute indication autobiographique. C’est l’unique Pléiade qui s’ouvre directement sur les ouvrages de l’auteur. Pourtant, sa vie n’a cessé de nourrir son œuvre. Le contexte historique a suscité chez lui l’écriture et la passion de raconter des histoires. L’exemple le plus fort est celui de Thomas, le chirurgien de «L’insupportable légèreté de l’être» qui, après l’invasion de son pays par les troupes soviétiques, se retrouve laveur de carreaux.
Méfiance, doute, incertitude, Kundera a cultivé la distance et l’oubli. Ce qui est magnifique, c’est que plusieurs générations dans le monde continuent de découvrir et de lire cet écrivain qui a été le témoin de son époque, une époque pleine de bruit et de fureur, d’injustices et de brutalités.
Il est l’un des rares écrivains à être traduit dans plus de soixante langues. En arrivant en France, il a fait retraduire certains de ses premiers romans, et a revu minutieusement leur traduction. Son exigence ne laissait rien au hasard.
Pour terminer, une anecdote: le rencontrant un jour dans les couloirs de la maison Gallimard, je lui demandais: «Comment vas-tu Milan?». Il me répondit dans un éclat de rire: «Sache que c’est une question qu’on ne pose plus à un homme de mon âge!»