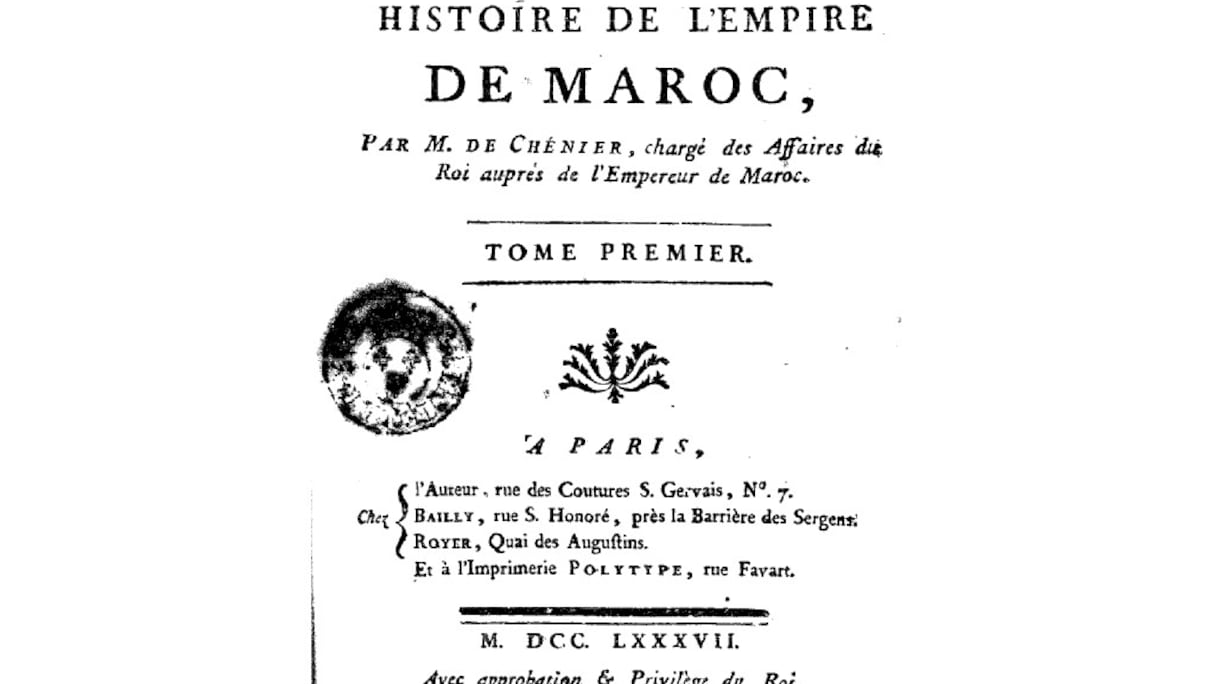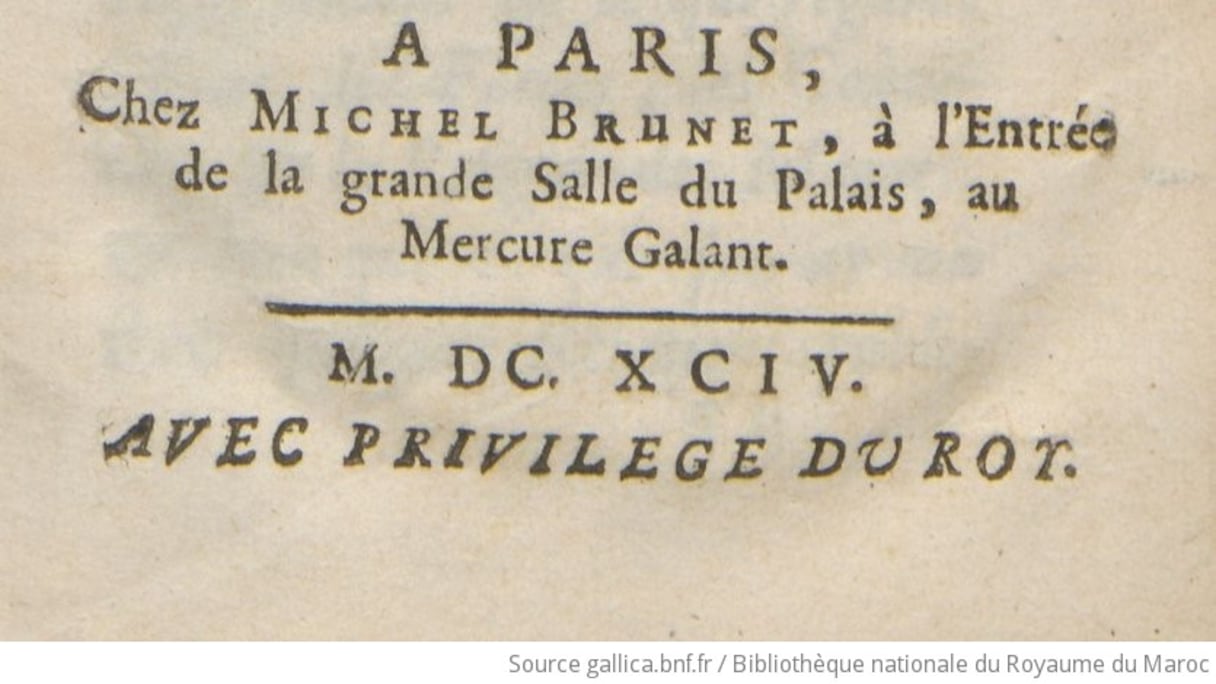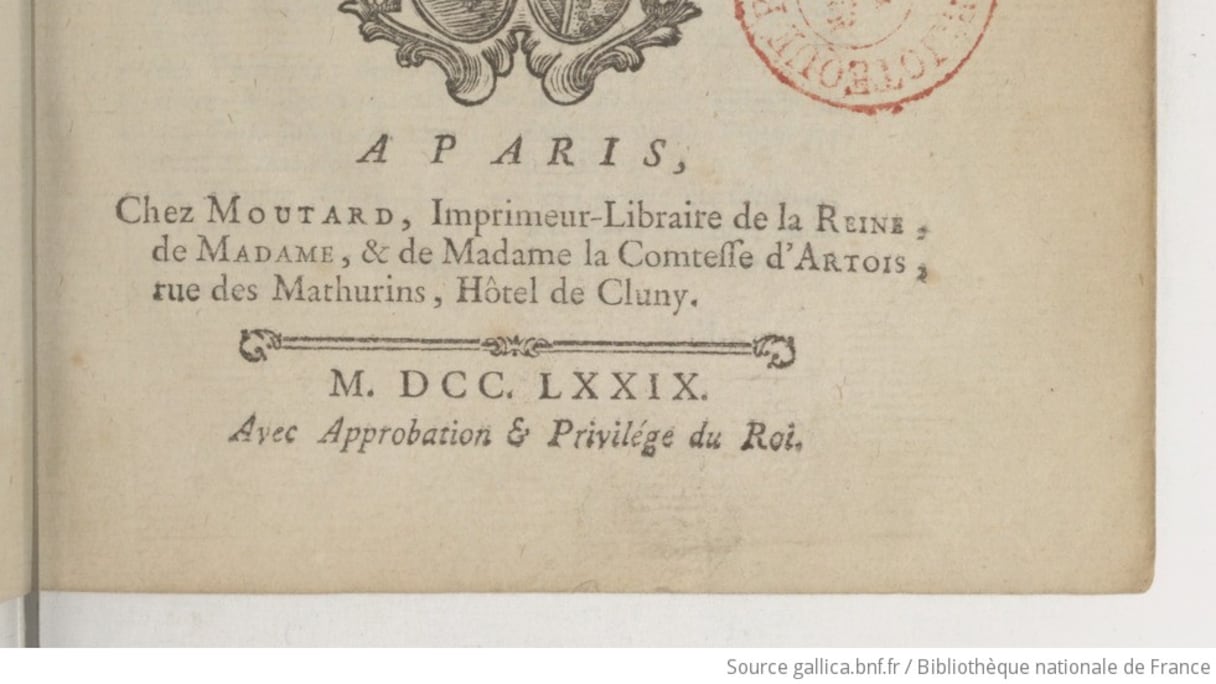Quelqu’un m’a récemment provoqué sur les réseaux sociaux. «Je te défie de prouver définitivement que le caftan est marocain!», a-t-il lancé. Il a sans doute rigolé derrière l’écran en croyant me tendre un piège à gibier. Pour moi, l’affaire de l’authenticité du caftan marocain était pliée et l’UNESCO allait inscrire le vêtement féminin au patrimoine immatériel du Royaume. L’organisme international qui ne joue pas avec de tels sujets fera son travail et vérifiera comme il se doit tous les critères d’éligibilité. Le Maroc a suffisamment d’éléments probants dans ce sens. Par ailleurs, l’histoire du caftan était connue de tous et retracée dans des ouvrages des 20ème et 19ème siècles attestant que cette belle parure filée d’or et d’apparats civilisationnels est née chez nous et a été sublimée de tout temps par nos stylistes, tailleurs, brodeurs et passementiers. Dans les salons bourgeois marocains, on aime évoquer le tableau impressionniste «Jeune Marocaine au perroquet» (1900) du peintre belge Frantz Charlet, où l’on voit une femme revêtue d’un caftan rouge et or avec toutes les caractéristiques d’ornement et de broderie qu’on lui connait aujourd’hui. Mais avant le 19ème siècle existe-t-il des preuves objectives du caftan marocain?
La première référence attestée sur le caftan marocain se trouve à la Bibliothèque nationale de France (BNF). Cette source historique importante contient des gravures jamais montrées du caftan marocain (voir ces gravures dans la galerie photos). Il s’agit du livre «L’Estat présent de l’Empire du Maroc» (1694, BNF) de François Pidou de Saint-Olon, ambassadeur du roi Louis XIV au Maroc. L’homme avait été chargé par le monarque français de conclure un Traité de Paix avec le Royaume. Il a longtemps séjourné dans la cour impériale avant d’être rappelé à Paris. Il laisse un témoignage émouvant doublé de dessins, sans doute les premières gravures du caftan marocain. Il décrit ainsi cette «robe» des femmes de bonne famille, juives et musulmanes dit-il, qu’il voit comme des élégantes qui se maquillent et prennent soin de leur beauté.
«Les manches de leurs chemises leur couvrent les bras et sont serrées jusqu’au poignet, et la longueur des caleçons qui leur descendent jusqu’au gras des jambes. Le col de leurs chemises est plié et presque toujours orné de quelque broderie, leur veste est ouverte par devant jusqu’à la ceinture, elles attachent aux manches de ces vestes de grands morceaux de mousseline, qui font le même effet que nos engageantes (vêtement français, NDLR), mais qui pendent beaucoup plus bas.» (pp.97)
François Pidou de Saint-Olon laissera aussi ce témoignage: «Elles portent dans leurs maisons un jupon fort court, et quand elles sortent en ville, elles s’entourent d’un hayque qui les couvre entièrement, depuis le col jusqu’aux pieds, elles se cachent aussi le visage, en sorte qu’on ne leur voit que les yeux. Quant à leur coiffure, elle n’est guère différente de celle des Espagnoles, dont elles font deux tresses de cheveux qu’elles jettent en arrière avec quelques plaques de turban, et ne se couvrent la tête que d’un simple voile ou d’un bandeau» (p.98).
Et voilà encore ce que cette source avérée dit sur le couscous marocain, déjà plat national à son époque:
«(...) Couscoussous qui est une pate faite de fine fleur de farine, et semblable à de l’anis un peu couvert, laquelle on a fait cuire avec quelques poules et des pigeonneaux, ou du mouton; ils mangent ce couscoussous à poignées, et en font une manière de petites lotes qu’ils lancent dans leur bouche» (pp.90-91).
Ce passage sur le couscous, magnifique et méconnue aussi, est une réponse lointaine de Saint-Olon, voix bienveillante dissimulée derrière les siècles qui nous est adressée.
Une deuxième source indélébile dans le temps se trouve à la Bibliothèque municipale de Lyon, dans une encyclopédie gigantesque de 100 volumes écrite entre 1680 et 1730 en Angleterre en anglais, traduite et publiée en français en 1742: «Histoire universelle: depuis le commencement du monde jusqu’à présent composée en anglais par une société de gens de lettres; nouvellement traduite en français par une société de gens de lettres (Volume 62)». Dans cette encyclopédie qui nous fait voyager à travers les peuples du monde, on trouve l’allusion au mot «caftan» consacré aux vêtements des femmes du Royaume du Maroc. Ses auteurs décrivent avec moult détails ce qui ne peut absolument pas être une tromperie culturelle:
«Les femmes attachent leur caftan avec une ceinture, comme les hommes, mais leurs ceintures sont généralement plus riches, et de plus de couleurs différentes, ou brodées, et au lieu du haïk elles ont une robe d’un beau bleu, qui leur vient jusqu’aux talons. Quelques-unes ont des anneaux qui vont à la cheville.» (p.274)
Planche du caftan marocain dans L’Estat présent de l’Empire du Maroc, 1694, de François Pidou de Saint-Olon (BNF)
Une troisième et dernière source historique sûre est l’écrivain diplomate Louis de Chénier, consul général du roi Louis XV puis du roi Louis XVI au Royaume du Maroc, entre 1767 et 1782. Ce De Chénier a passé 15 ans chez nous et apparait comme passionné par les hommes et les femmes du pays devenu le sien. Il a publié un ouvrage magistral en 3 tomes: «Recherches historiques sur les Maures et Histoire de l’Empire du Maroc» (1787), disponible à la BNF. Il a aussi laissé une correspondance officielle et privée abondante en 10 tomes, étalée sur toutes ces années marocaines, déposées aux Archives nationales de France. Il s’agit là d’une source importante sur l’histoire du Maroc (qu’il nomme Empire du Maroc) entre le début de la conquête islamique et le 18ème siècle. Il considère dans ces livres que les Marocains sont les Maures d’Espagne. Voici ce qu’il écrit sur le caftan:
«Les femmes qui habitent les villes sont là, comme ailleurs, plus occupées de leur parure que celles de la campagne, mais comme elles ne sortent guère qu’un jour de la semaine, elles se parent rarement (…) Lorsqu’elles s’habillent, elles ont une ample et belle chemise de toile, brodée en or sur le sein, un caftan, riche en étoffe, en drap, ou en velours brodé en or (…) Elles portent sur leur caftan une ceinture en velours cramoisi (couleur rouge foncé, tirant sur le violet, NDLR), brodée en or, avec une boucle d’or ou d’argent (Mdama, NDLR), ou bien des ceintures en étoffe brochée, des fabriques de Fès.» (p.126)
On le voit dans ces trois plus anciennes sources, depuis près de 350 ans, le caftan a été considéré par les Anglais et les Français comme un vêtement éclos au Royaume du Maroc. Cette robe d’apparat féminine était assez répandue et importante dans la société marocaine, et si sexy pour les voyageurs et les diplomates, pour devenir rapidement une matière d’écriture retenue par la postérité. La présence du caftan marocain est attestée dans les chroniques littéraires, les histoires universelles des peuples (un genre littéraire prisé à l’époque) et les comptes-rendus et les correspondances des ambassadeurs. Des témoignages crédibles et neutres qui résonnent de loin. Ce même exercice de recherche doit être réalisé pour les archives diplomatiques et littéraires espagnoles notamment. L’histoire des pays se forge aussi par les sources anciennes des autres peuples. Mieux: l’argument d’autorité des références bibliographiques est considéré comme une preuve scientifique dans les méthodologies de la recherche, chose que n’ignorent pas l’UNESCO et les responsables marocains du dossier culturel «caftan». En l’occurrence, ce sont des traces qui ne s’effacent pas sur le caftan marocain depuis 1694 au moins. Têtues comme la vérité et laissées là pour les siècles à venir, pour nous, pour cette chronique et être utilisées.
Finalement, relever le défi sur les réseaux sociaux avait du bon.