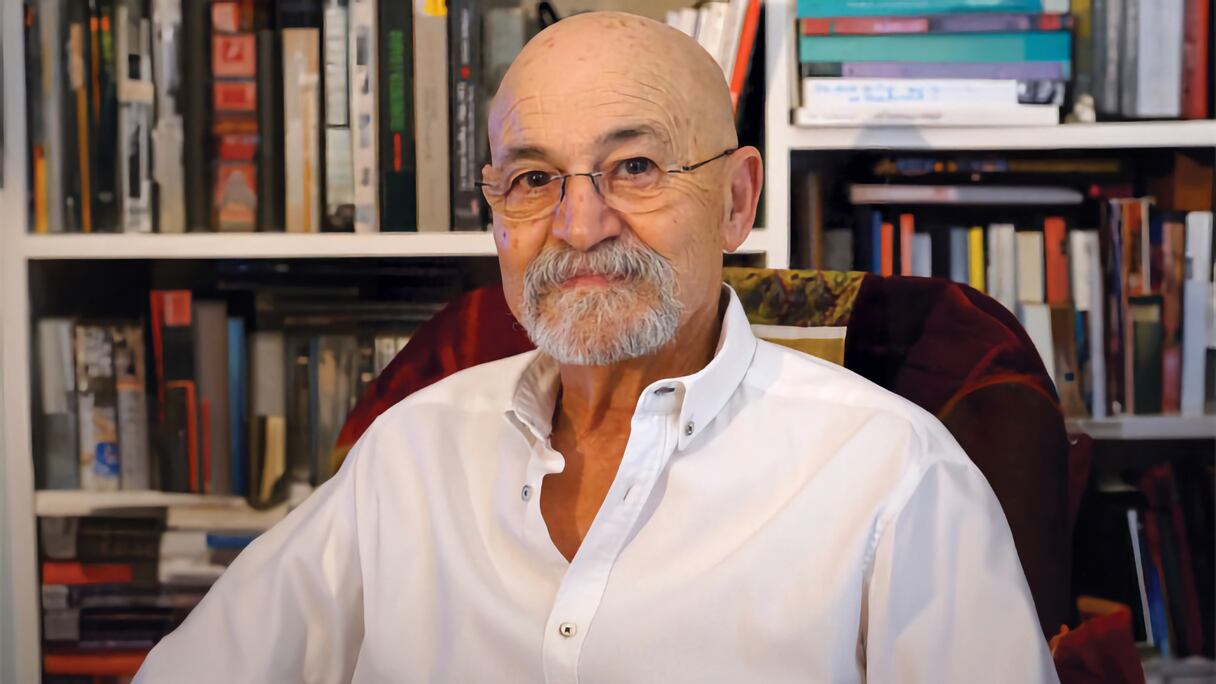Mohammed Serifi-Villar se présente comme «un jeune révolutionnaire marocain, qui fut d’abord condamné à perpétuité par contumace, puis à trente-deux ans», un homme traumatisé, violenté qui cherche «l’intensité de la lumière dans les tunnels les plus ténébreux», où il aura finalement passé dix-huit ans. Cet ex-militant du mouvement Ilal Amam ne tombe pas dans le piège de la victimisation et du pathos. Il cherche l’apaisement, à dénouer les fils retors de la mémoire, à retrouver le récit de sa propre histoire, dont il veut finalement se débarrasser comme un poids longtemps porté en soi: «Lorsque je prenais la plume pour parler du passé, j’avais l’impression de m’adresser à un «moi» qui disparaissait». Ce récit des épisodes qui ont marqué sa vie carcérale doit «faire naître sinon un sourire, du moins une lueur d’espoir».
L’arrestation, source d’événements rocambolesques autour d’un «coffre secret»
Les premiers chapitres narrent les événements de novembre 1974 qui verront l’arrestation d’Abraham Serfaty, alias «Demnati» tombé dans le filet de la police politique. Mais aussi d’une grande partie de la direction du mouvement dissident «23 mars» et d’Abdelatif Zeroual, ce dernier finira par mourir «sous la torture le 14 du même mois». C’est aussi à ce moment-là que l’auteur, Mohammed Serifi-Villar, est arrêté par quatre gorilles, surgissant d’une voiture en apparence banale, «si rassurante par la présence de cette femme allaitant son enfant». Il va dès lors vivre les pires moments de sa captivité, sommé par son geôlier à des «aveux complets». Celui-ci lui « montre une clé d’un coffre-fort » dont il devra révéler le lieu de cachette. Apparemment, ce coffre dissimule des carnets importants et secrets sur les traquenards qui pendent dans le ciel du Maroc. Mais, le torturé ne savait pas de quel coffre le bourreau parlait.
Sous le poids lourd de l’histoire, l’auteur dévoile les souffrances vives des survivants et les espoirs tenaces qui les habitent, telles des braises sous la cendre: «Une des séances de tortures me revient tout spécialement. Les commanditaires cherchaient à savoir si nous avions des liens avec les groupes armés, surtout le groupe de Dahkoun, la branche militaire de l’USFP, avec les militaires ayant participé aux coups d’État, avec le Polisario, et si, dans l’organisation, le recours aux armes avait été évoqué».
Les Années de plomb vues par un marxiste-léniniste
La mémoire de l’auteur est une pellicule sans fin, déroulée sous l’œil du lecteur, où chaque image ravive les brûlures du passé. Il se souvient de l’année 1959, quand le vent du complot soufflait contre le prince héritier. Cette trame sombre de l’histoire se tisse avec les récits des cellules exiguës, où les voix étouffées chuchotent encore les idéaux d’un autre monde où l’auteur a longtemps habité. À chaque ligne, c’est la condition humaine qui se déploie, nue et vulnérable, cherchant désespérément à redéfinir son essence au cœur des chaînes sociales et des barrières politiques: «Beaucoup rêvaient de l’instauration d’une monarchie parlementaire. Les dissensions entre les différents partis, y compris à l’intérieur de l’Istiqlal, étaient déjà importantes.»

Mais plus encore, ce récit est un appel à regarder en face l’impitoyable réalité des idéaux perdus et des combats trahis. C’est une quête de sens au milieu de l’absurde, où l’homme lutte pour respirer, pour exister, dans une société qui l’emprisonne. Le ton devient alors à la fois celui de l’indignation et de la tendresse, de la révolte et de la poésie. La parole, ici, est arme et refuge, cri et prière.
Derrière tout homme se cache une femme…
À travers son récit, Serifi-Villar nous offre un regard intime sur les origines de son parcours, comme un fil d’Ariane tissé dans les méandres de l’histoire. La toile de fond de son engagement prend racine dans l’Espagne tourmentée de Franco, où la quête effrénée d’une république perdue résonne comme un écho obsédant. C’est un monde où la répression et l’espoir s’entrechoquent sans cesse, façonnant des générations entières dans le creuset d’un idéal, qui, sournoisement pour l’auteur, allait finir dans la réhabilitation de la monarchie espagnole. Cette Espagne, c’est aussi celle de sa mère, omniprésente dans ce récit, au patriotisme farouche, dont le regard empreint de fierté et de douleur nourrit l’âme du jeune Serifi-Villar. Sa voix, empreinte de récits et de larmes retenues, transmet au fils une culture ibérique qui se grave en lui, le marquant de manière indélébile.
À Tanger, où la famille s’est installée, l’Espagne n’est jamais loin; elle devient même une première patrie, omniprésente dans les rues et les maisons, dans les poèmes de l’auteur qu’il reproduit en espagnol dans ce livre. Cette ville cosmopolite, baignée par les vagues de la Méditerranée et les parfums d’Afrique, devient un carrefour d’identités, un lieu où la mémoire espagnole se mêle à la politique marocaine. La famille y prospère, d’abord dans le dénuement et la pauvreté, vivant dans une cabane, partagée entre deux rives, deux cultures qui s’enlacent et se heurtent, mais qui nourrissent toutes deux son esprit rebelle et idéaliste. C’est dans cette ambiance singulière sans frontières que prend forme l’homme engagé, déterminé à redéfinir les contours de sa propre existence et à donner un sens à son combat politique. Il confie: «Mohammed fut appelé El Niño, par sa mère, toute sa vie, puis très rapidement, Rojo, par les amis. Rojo le «rouge» en espagnol, mais «le Républicain» pour les Marocains puisqu’il était le fils d’une républicaine espagnole».
Un récit carcéral d’une rare intensité, où l’expérience de l’enfermement se mêle à une écriture saisissante
L’œuvre de Serifi-Villar a quelque chose d’envoûtant, une intensité presque hypnotique qui capte le lecteur dès les premières lignes. À travers ses mots, l’auteur parvient à transcender les murs oppressants de la prison pour plonger dans les méandres de l’âme humaine, révélant des profondeurs insoupçonnées de douleur, de résistance, et parfois même de rédemption. Cette littérature de l’enfermement, loin d’être simplement un témoignage, se transforme en une véritable expérience intérieure, où chaque page devient le reflet des combats intérieurs de l’auteur. Le lecteur, guidé par une prose qui oscille entre brutalité et poésie, se retrouve à son tour enfermé dans cette quête de sens, captif des mots autant que des murs décrits.
Les cellules deviennent des métaphores vivantes de l’existence, des espaces réduits où l’esprit se débat, se libère, et se recrée. Cette catharsis, loin d’être une simple purge de la souffrance, devient une régénération: une possibilité de renaître de ses cendres, de repenser le monde, et de retrouver une forme de lumière intérieure malgré les ténèbres du cachot.
Dans son récit de 330 pages, l’auteur déploie une prose dense et évocatrice, teintée d’un réalisme brut et d’une profondeur psychologique marquée. Son écriture, bien que précise et structurée, laisse place à des digressions méditatives qui enrichissent l’intrigue sans la ralentir, offrant au lecteur une immersion totale dans l’univers complexe qu’il décrit. Le récit se distingue surtout par la complexité morale des personnages. Serifi-Villar n’hésite pas à explorer leurs ambiguïtés et leurs contradictions, les rendant ainsi profondément humains.
«Le ciel carré», de Mohammed Serifi-Villar. 330 pages. Éditions Le Fennec, 2024. Prix public: 140 DH.