L’histoire commence en 2018 quelque part entre New York et Milan, rattrapant le temps perdu d’une génération marocaine aisée, devenue adulte, et partie à l’aventure dans le monde. La clique de joyeux luron(ne)s, insouciante, a fréquenté trente ans plus tôt le même lycée français huppé à Rabat. Une boîte de Pandore que la narratrice va ressusciter à travers des portraits attachants et une histoire d’amour personnelle mal pansée, qui tire la pelote du récit du «Premier été».
Ce jour-là, Dino, artiste saltimbanque qui veut donner un sens boccacien à sa vie, prévient par un SMS lapidaire Tanina (Tanya pour ses proches) qu’un de leurs anciens amis de Rabat est mort. Il lui envoie aussi une photographie de classe de Terminale. La narratrice est alors envahie de souvenirs lointains. Sur ce vieux cliché, un autre garçon éveille en elle des sentiments terrés à jamais. Le fil d’Ariane va se dérouler dans sa mémoire, imperturbable comme le temps. Un livre tendre, féminin, intimiste où l’auteure n’hésite pas à chanter la beauté des hommes et l’ivresse de l’amour, à se faire toute molle quand les évocations deviennent chastes: «Je te cherche. Sous la voûte de ton corps qui se penchait pour me couvrir, dans l’étendue lumineuse de ta chair où je me perdais, dans ce monde naissant et rayonnant où nous nous sommes aimés. Je te cherche» (p.15).
Le langage sait devenir par endroits truculent, avec un vocabulaire rappelant les codes des jeunes à l’époque: «Il se met à crier pour montrer l’importance des jours qui approchent: “C’est les grandes vacances, l’été, l’glandage, la bringue et les grasses mats, capiché al kanbouyettes! Alors on bondit d’une joie énorme, une joie d’gorille comme ça”!» (p.20)
Noor Ikken s’imprègne de sa propre histoire, mais «Le premier été» n’est pas une autobiographie en filigrane. Le roman ne se limite pas à de l’égotisme romanesque. L’auteure réussit à donner vie au Maroc des années 80 et à cette jeunesse dorée marocaine devenant le vrai sujet de la prospection. Kokis, les cousines Hanna et Nora qui prendront des directions différentes dans la vie, le père de Dino, tante Boul, Raphaël (le garçon troublant de la photographie), et bien d’autres personnages égrènent ce conte sur l’innocence perdue. Le Maroc vit une intense transformation sociale à ce moment-là dont la clique de Tanina devient un miroir, pour le meilleur et pour le pire: «À minuit, les adultes dorment, ils ont boulot le lendemain. Les adolescents, en revanche, sont sur la terrasse de Dino. À minuit on entend de la musique, le bruit de quelques bouteilles de bière et des rires qui suivent une drôle d’odeur.» (p.99)
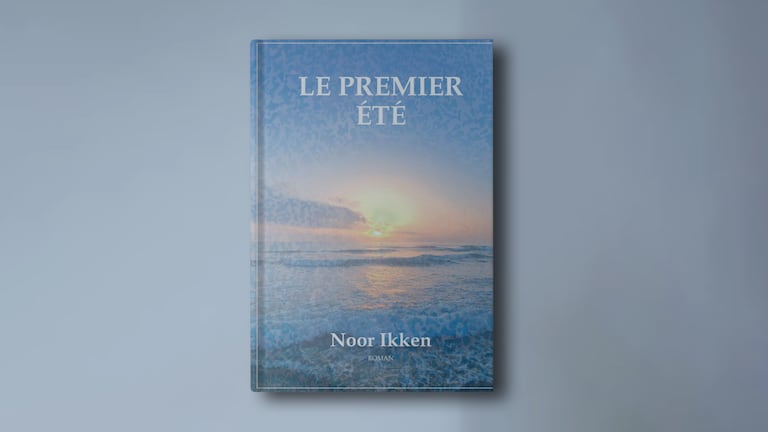
Le choix de faire vivre une bande d’amis sympathique aux destins antinomiques brosse in situ une génération bohème et impulsive qui choisira l’art plutôt que l’engagement politique. Un discours assumé de la bourgeoisie qui présente le visage d’un Maroc moderne et en marche, qui contraste avec certains récits misérabilistes plus «à gauche» que beaucoup d’auteurs ont commis sur notre société. Certains regretteront dans «Le premier été» l’absence d’un Maroc traditionnel millénaire, l’image d’Épinal de la rue populaire, et sans doute la présence de personnages plus ancrés dans la culture locale. Mais c’est aussi une histoire de départs, de déchirements, d’amitié et de familles qui se cherchent sans retrouver définitivement leur âme commune. Petit à petit se dévoile une deuxième couche de l’histoire à travers la génération des parents où se nouent des drames en silence. Comme pour Adib, le père de Tanina: «Vingt ans plus tôt, lorsque Adib, le père de Tanya, grand frère de Lily et deuxième fils de Madame, décida enfin de se marier, il fallut d’abord, marquer l’élue. Malgré son air péjoratif, le terme “marquer” qui fait penser à “marquer au fer blanc une vache qui vous appartient ou marquer d’une croix rouge, le mouton qui va à l’abattoir” est un terme usité jusqu’à nos jours. Il est promesse de mariage, synonyme de fiançailles. L’élue est marquée à l’or fin, elle reçoit un bijou pour être réservée, une sorte d’avance sur achat.» (p.121).
Noor Ikken s’attarde à décrire les lieux de vacances courus à l’époque par cette jeunesse. C’était avant le téléphone portable. Les jeunes passent leurs vacances d’été au bord de la mer (où se déroule en partie le roman) dans des cabanons qui taisent les secrets des adolescents: «Vague après vague, la mer installe le silence, les yeux commencent à se fermer, on a sommeil, un peu froid aussi, les corps se recroquevillent, les plus avisés ont ramené un drap ou un plaid. La cassette chante Somebody de Depeche Mode.» (p.131) Beaucoup de lecteurs, notamment les nostalgiques, s’y retrouveront.
En 310 pages bien séquencées dans de courts chapitres qui se lisent vite, cette jeunesse vibre de passion et d’attente. Style plein de fraîcheur et privilégiant les dialogues qui instaurent une familiarité de facto avec les personnages. Et incisif jalonné de références culturelles sur l’art, les artistes modernes, les courants de peinture. Noor Ikken démontre dans ce premier opus une belle maîtrise des ficelles de l’écriture. Elle ne s’embarrasse pas d’idéologie et laisse le verbe nous attendrir. À lire.
«Le premier été», de Noor Ikken. 310 pages. Maha Éditions, 2024. Prix public: 120 DH.









