«Mater Africa» est le premier roman de Kenza Barrada. C’est un récit touffu, dense de 420 pages (25 chapitres), pour celles et ceux qui aiment les grands voyages de la vie. L’auteure nous entraîne dans une mémoire oubliée, proche et lointaine de nous: les racines africaines de la marocanité. L’intrigue se tisse subtilement entre le 19ème siècle et notre époque, en passant par l’indépendance du Maroc, avec des effets de prolepses et d’analepses qui nivellent la lecture sans la perturber. On se laisse emporter par le style horizontal de l’auteure, une composition linéaire réaliste qui coule telle une rivière africaine.
«Mater Africa» relate de vrais destins biographiques de quatre femmes flamboyantes. Une mère, ses deux filles et sa petite-fille rebelle. L’écriture arrive à réinventer ces tranches de vie en personnages romanesques. Il y a la mère, Mariame, une Sénégalaise, trente ans au début de l’intrigue, sa fin sera tragique. Elle est mariée à un Marocain, un commerçant fassi du Fès d’antan, Haj Omar, riche propriétaire qui a réussi dans les affaires au Sénégal et a déjà un pied dans l’au-delà mecquois. Elle a eu plusieurs enfants avec lui, notamment deux filles, Habiba et Amina, héroïnes du roman que la narratrice va suivre tout au long de leur existence. Tout se passe entre deux mondes qui se réverbèrent ou, mieux, se rétrodiffusent. Haj Omar, tous les soirs, tel un chef de tribu «trônait sur son fauteuil au milieu de la case, les enfants assis à ses pieds» (p.20). Il est «un minaret, aussi droit que celui du village» (p.22). Il aime sa femme, mais à sa manière. Mariame, elle, «incarnait la beauté de Sine Saloum» (p.19). Les baies de Sine Saloum, classées parmi les plus belles du monde, possèdent des courbes féminines de vert jade ou turquoise, qui deviennent bleu indigo sous les saisons des pluies. Son époux décide de partir, lui et ses filles, pour toujours, au Maroc. Il veut les voir grandir dans la gloire de ses ancêtres maures. Il pense faire fléchir Mariame pour la laisser au Sénégal. Il prépare une deuxième vie, sans la première épouse. C’est l’histoire d’une déchirure de la filiation et d’un drame. Mariame sera sacrifiée et connaîtra une fin pathétique.
Amina et Habiba grandiront au Maroc. Habiba gardant un lien indélébile, viscéral, avec l’Afrique. Elle est revenue vivre au Sénégal, sa patrie de naissance, veut en repartir, ne s’y résigne pas, ne sait pas où placer le curseur de son existence, tandis que ses frères et sa sœur Amina n’y ont plus mis les pieds depuis 50 ans. Habiba, mariée à Idriss, un pieux musulman fana de foot, est une femme angoissée, qui symbolise la recherche de soi. Elle vit dans ses souvenirs, regrette sa mère qu’elle voit souvent en rêve et qui a fini par être emportée par la rivière Sine Saloum, happée par son double animiste: «Elle m’a dit des choses étranges… Elle m’a demandé de réunir ma sœur et mes frères (…) que nous devions faire la paix avec le Sénégal, que c’était important pour les générations futures qui descendent de notre arbre sacré» (p.39). Comme une antique légende dans le village, on entend parfois, au détour des pages, le son des tam-tams et les chants des griots. L’une des forces de ce roman est de mélanger les cultures et les caractères dans la famille de Haj Omar. Habiba finira par faire son choix. Elle choisira l’un des deux pays.
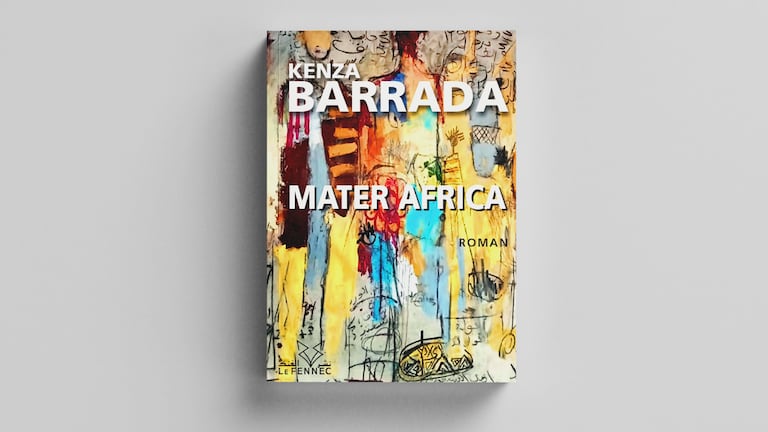
Il y a dans cette galerie de portraits réussis, Amina, la seconde fille de Mariame. Elle est belle, portée sur le sexe et les hommes qui n’hésitent pas à la solliciter, malgré son mariage bourgeois avec Moha. Elle vit à Casablanca, dans une villa coquette sise impasse des Papillons, roule en Mini et s’habille selon des dernières tendances. Elle fréquente la discothèque Paradise et s’occupe en journée de ses amants, et à parfaire maquillage et taille coquine. Elle aime «passer le bout de son ongle sur le contour de ses lèvres, enlevant le gloss qui en dépasserait» (p.45). C’est le piège du désir. À sa façon, Amina est traumatisée par l’histoire familiale. Elle se détruit dans le plaisir. Son mariage est un échec. Seule sa fille Zahrat semble une promesse, un don du ciel.
Zahrat, une jeune mutine qui représente le juste métissage de la famille de Haj Omar: «Elle applique, minutieuse, le maquillage sur son visage, une dizaine de produits spécialement créés pour peau noire à tendance grasse, pour yeux marron aux longs cils, pour lèvres charnues de couleur cerise» (p.57). Petite-fille de Mariame, dont elle n’a qu’une vague ressouvenance familiale, elle est détachée de tout. Mais tout le roman tend vers elle. Elle ne connaît pas l’Afrique, et vit dans un Maroc qu’elle veut moderne, laïc, occidentalisé. Zahrat pratique le yoga, aime écouter «La matinale de Momo», sort la journée avec ses écouteurs. Elle rebat les cartes de la féminité et trouve sa place dans le monde. Elle aime Paris où elle va longtemps séjourner, vit des histoires d’amour, fréquente des jeunes branchés et mondialisés. Zahrat, en cherchant l’amour, retrouve son africanité.
Finalement, quatre univers féminins se guettent, et chacun détient une partie de la réponse. Un rébus dont la clef pour comprendre est livrée tardivement, à travers le personnage de Zahrat. La petite-fille bourlingueuse se réconcilie avec sérénité avec ses origines africaines. Elle symbolise la nouvelle génération. C’est un point de départ. Ces quatre histoires principales, de mère en fille, se télescopent dans un paysage génétique épique. Chacune des héroïnes aura une destinée inattendue que le lecteur ne subodore pas de prime abord. Et lorsque le lecteur referme définitivement le livre, une question brûle ses lèvres: peut-on être Marocain sans être Africain?
«Mater Africa». 420 pages. Éditions Le Fennec, 2024. Prix public: 140 DH.













