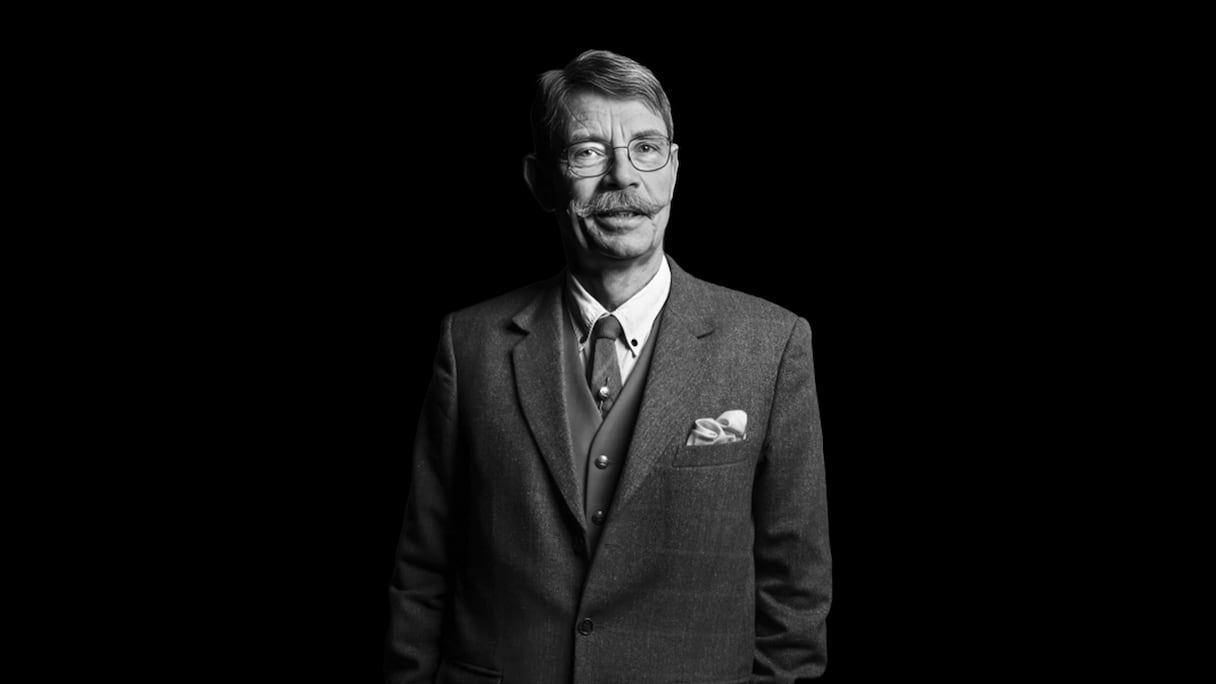Au sud du Sahara, la colonisation a eu pour principale conséquence le bouleversement des rapports de force internes. Quand les Européens installèrent des comptoirs sur le littoral atlantique africain, ils firent ainsi basculer vers l’océan le cœur économique et politique du continent qui battait alors dans la région du Sahel. Les axes commerciaux sud (forêt) - nord (Maghreb), furent alors attirés vers le golfe de Guinée et la Sénégambie et les pistes sahariennes occidentales furent largement abandonnées.
L’historien portugais Magalhès Goudinho a résumé le phénomène d’une image: «la victoire de la caravelle sur la caravane». Le littoral de l’Afrique noire atlantique, jusque-là marginal dans l’histoire du continent, devint en quelques décennies le principal pôle économique et politique de tout l’Ouest africain et cela pour plusieurs siècles, avec un essor tout à fait particulier à l’époque de la traite, de puissants royaumes se constituant là où les Européens venaient accoster pour y acheter des esclaves à leurs pourvoyeurs noirs.
À partir de la fin du XVIIIème siècle, et surtout au XIXème, se produisit une renaissance sahélienne autour de sultanats nordistes qui entreprirent de s’étendre aux dépens d’entités sudistes appauvries par la fin de la traite des esclaves, décidée unilatéralement par les Européens. Mais alors que les nordistes s’apprêtaient à subjuguer l’Afrique littorale, la colonisation se fit à leurs dépens.
À la fin du XIXème siècle, la poussée coloniale britannique se fit en effet depuis les côtes et, à l’exception de la résistance du royaume Ashanti, elle progressa sans grandes difficultés. Les troupes anglaises furent généralement bien accueillies par des populations sudistes -notamment dans le futur Nigeria-, qui voyaient en elles une protection contre les guerriers musulmans et esclavagistes nordistes.
La poussée française, qui se fit aussi par l’axe fluvial Sénégal Niger, eut également pour résultat la destruction de sultanats musulmans nordistes (Empire d’Ahmadou, de Rabah, mais aussi de Samory, etc.) et cela pour le plus grand profit des populations qu’ils tenaient en soumission.
La colonisation tua donc dans l’œuf la tentative de renaissance sahélienne au profit de ces pôles littoraux nés de la découverte portugaise trois siècles plus tôt et qui avaient été ouverts aux influences culturelles et religieuses européennes.
La colonisation a ainsi «cassé» ou provoqué la mutation de plusieurs «Prusse» africaines potentielles: l’Empire de Sokoto, le royaume Ashanti, le Dahomey, les ensembles conquérants créés par el Hadj Omar, par Samory ou par Rabah, mais également Madagascar et la monarchie hova-mérina. Elle en a subjugué d’autres, les arrêtant à un moment de leur histoire comme l’État Tutsi rwandais coupé de son exutoire de l’ouest Kivu et maintenu sur les hautes terres bordières de la crête Congo Nil. Elle a également figé la tectonique de mise en place des peuples, comme dans le cas de la Côte d’Ivoire, de l’Afrique du Sud ou du Zimbabwe. Elle a parfois inversé les rapports de force en affaiblissant certaines ethnies et en renforçant d’autres, comme en Namibie par exemple, avec l’élimination des Herero au profit des Ovambo. Elle a aussi procédé par amputation comme dans le cas du Maroc, État millénaire territorialement amputé au profit de l’Algérie née de la volonté française.
La décolonisation confirma l’inversion des rapports de force ethniques provoquée par la colonisation. Les anciens dominés devenus les cadres locaux du pouvoir colonial héritèrent souvent des États artificiels légués par les anciens colonisateurs et à la tête desquels ils furent placés. L’ethno-mathématique électorale attribua ensuite la légitimité et donc le pouvoir aux plus nombreux. La loi du nombre, inconnue de l’ordre naturel africain, bouleversa alors une harmonie sociale fondée sur l’autorité naturelle, les hiérarchies héritées, le respect et la soumission.