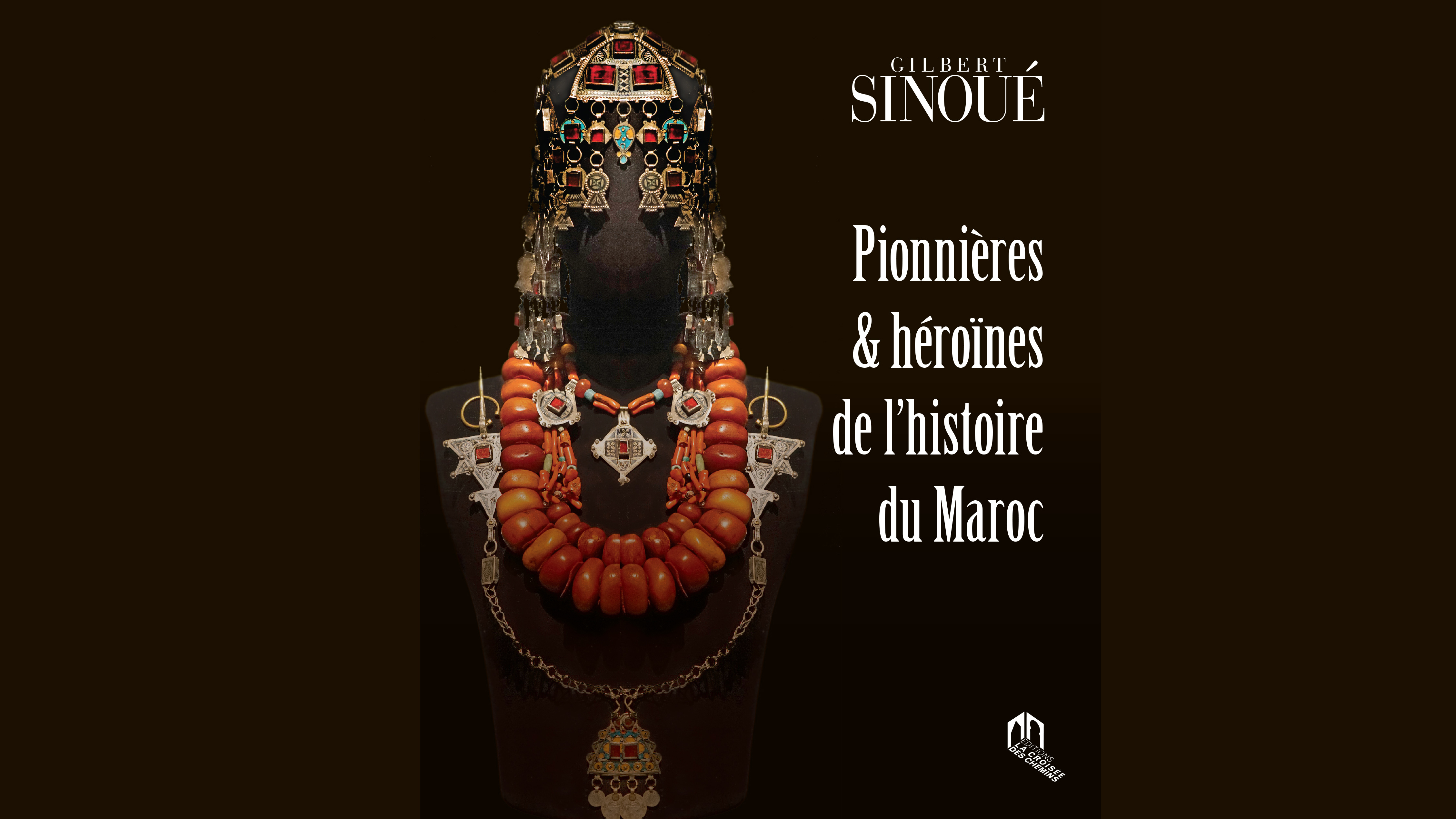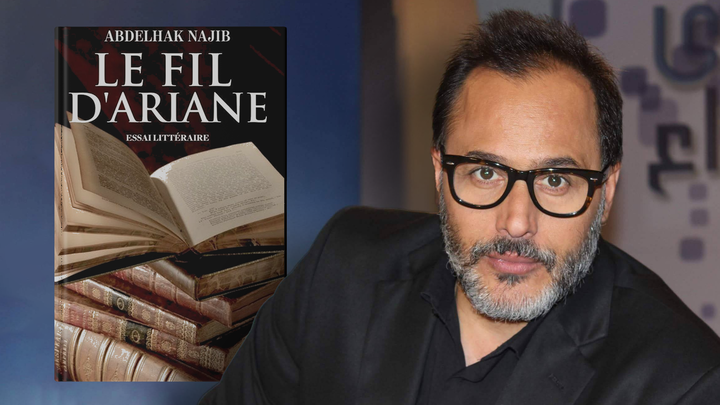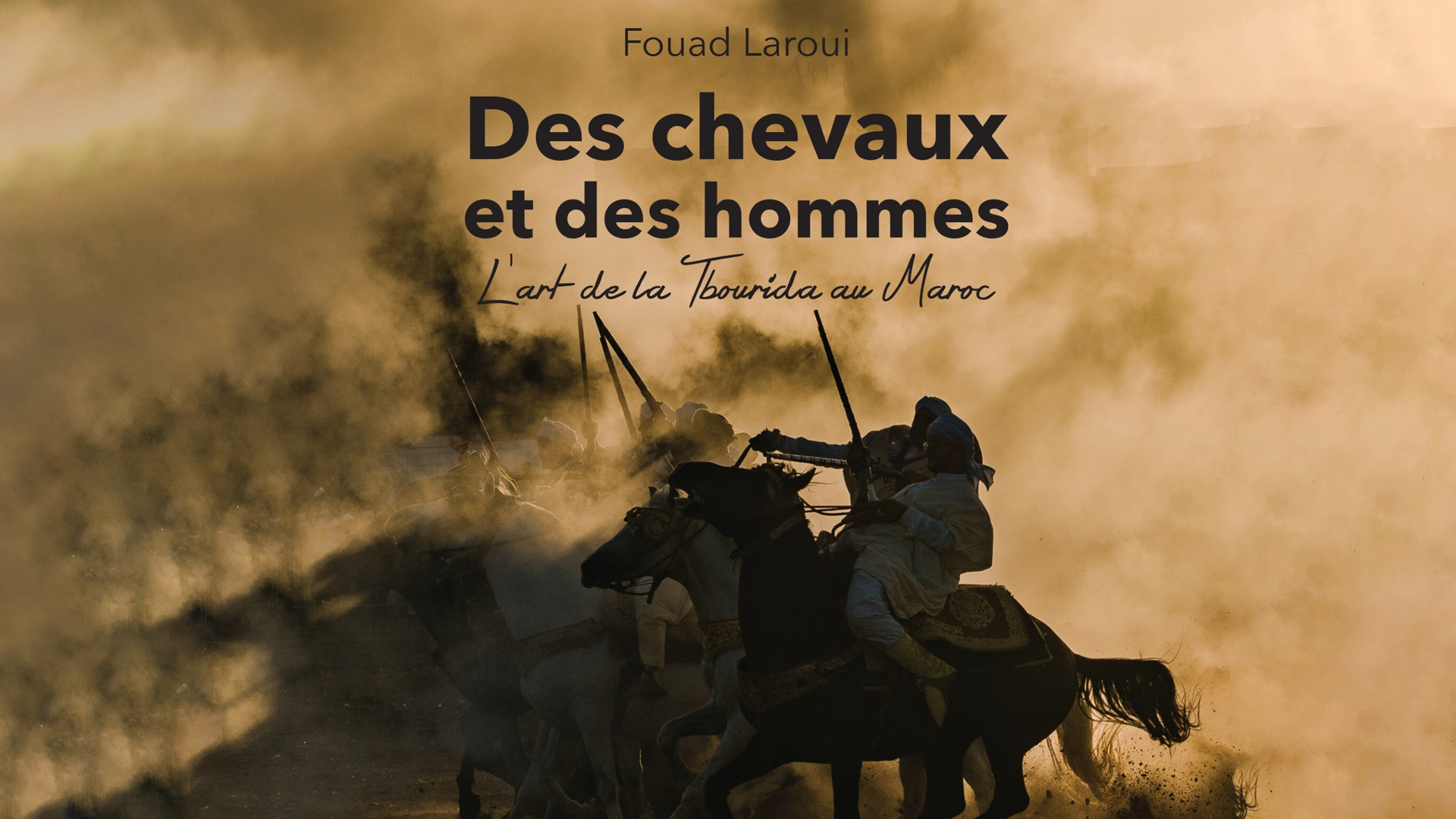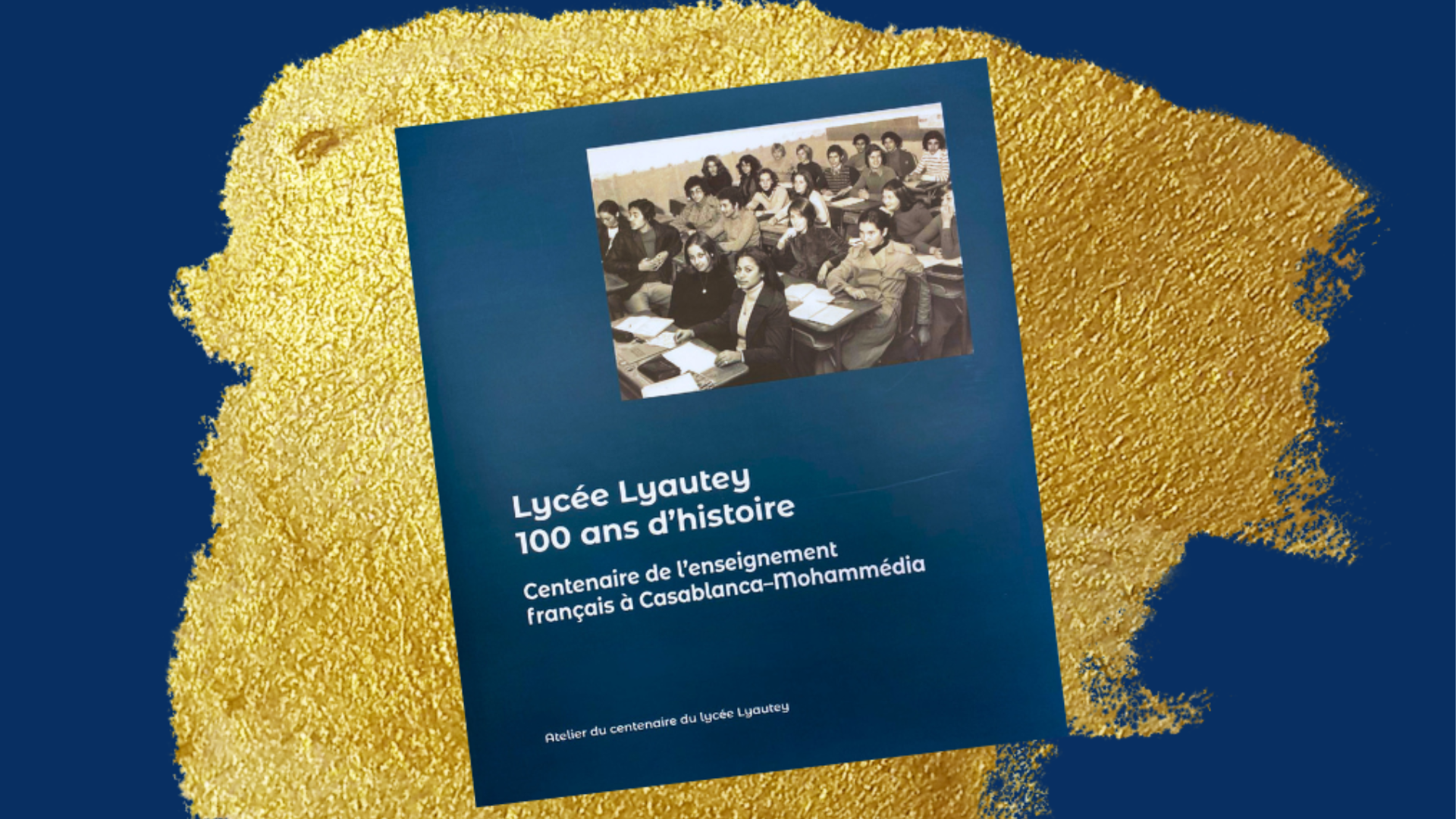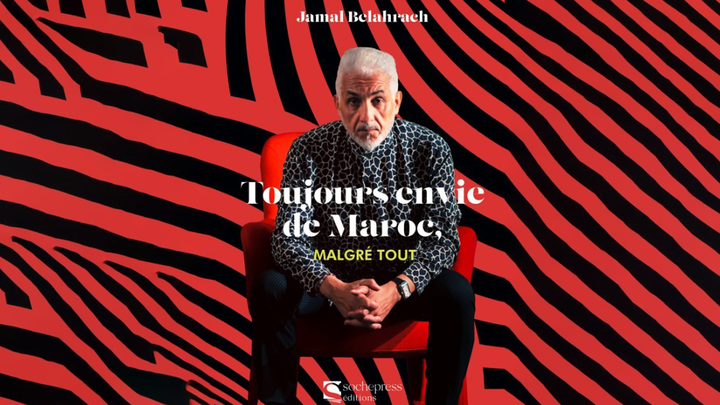Ce livre de 196 pages truculentes n’a pas de genre littéraire spécifique. Il vaque à mélanger narration et poésie. Le lecteur n’y trouvera pas de thème horizontal ni une intrigue vraie, mais plutôt un fil poétique qui traverse l’œuvre, sublime. Il n’y rencontrera pas de personnages bien campés avec un passé, un tempérament, un destin propre. On n’y dénichera pas non plus de héros ou d’antihéros, c’est un livre sans début ni fin. Or chaque page est un tableau de vie peinturluré de légendes personnelles du poète, un imaginaire interminable, sorte d’annales akashiques ressuscitées au détour de mots intérieurs et de phrases charnelles devenant bientôt les personnages vivants du livre.
Une composition magistrale où le vocabulaire se transforme en une femme aimée jadis, en des êtres qui hantent inlassablement Nissabouri, des histoires saugrenues de jeunesse, des moments intimes de l’existence volés à leurs décombres. Le narrateur vit sa mue et devient une narratrice, régressant somptueusement jusqu’au trouble de l’adolescence pour décrire une langue aux secrets féminins sacrés. Celle-ci ne peut «s’écrire qu’en lettres d’or» (p.163), nous prévient le poète.
Dans le monde de Nissabouri, les humains parlent aux mots et rendent visite «quelques fleurs à la main, à des phrases convalescentes» et à des «romances périssables» (p.9). Des mantras qui finissent par habiter les existences à la condition éphémère, un immense grenier rempli de souvenirs de tout genre de Nissabouri, dedans l’on s’y promène indéfiniment. Cela, dit-il, s’est passé «près d’anciens vestiges, dans le voisinage de ruines rarement visitées, dans une habitation retirée au bord d’une falaise, d’où l’on pouvait voir le cœur des vagues» (p.25). C’est là que le poète a trouvé son poème rejeté par la mer (par la mère!).
Lire aussi : Récompense. Abdellatif Laâbi reçoit le Grand prix de poésie 2024 de l’Académie des Jeux floraux de Toulouse
Organisé en 35 petits chapitres de 2 à 3 pages, «La variable poétique en premier» s’offre à lire section après section, invitant le lecteur à une stratégie de repli. Il faut prendre son temps dans le plaisir. L’enjeu devient une contemplation esthétique, un voyage dans la langue sans envisager sa destination. Il s’agit de l’aventure d’une écriture (et non de l’écriture d’une aventure), comme aimait à dire l’écrivain Jean Ricardou théorisant le nouveau roman. C’est aussi un pont pour l’art pour l’art, ce livre est un tableau parnassien dans un musée de vocabulaire dont les nuances des couleurs et l’ombre des formes sont plus importantes que le sujet.
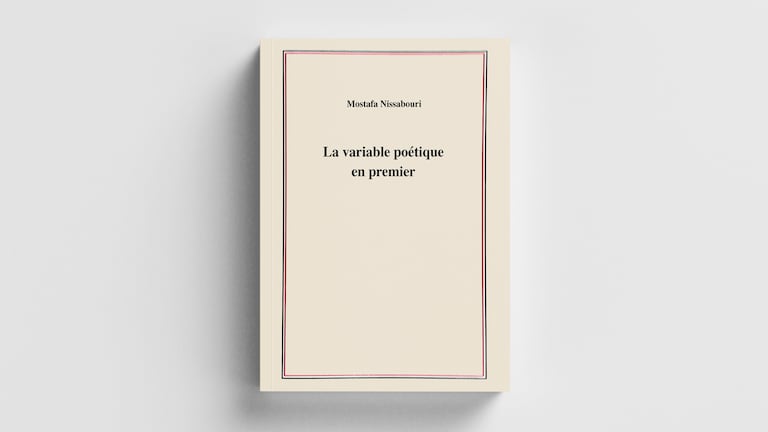
À ce voleur de feu, la langue fait don d’enchantement et de magie qui s’emparent du réel et le métamorphosent en mythe personnel de l’auteur. Des impressions humaines nous submergent: le temps qu’on ne peut suspendre, la mort et l’enterrement, l’amour et ses désirs éreintants, la famille, l’enfance perdue, l’au-delà mystérieux avec ses rébus. Ainsi en va-t-il des multiples effondrements de la vie qui surviennent au moment où «la lumière astreinte à la moitié du ciel» (p.47). Mais l’homme, inachevé dans la création divine, continue pourtant de croire qu’il peut se reconstruire dans une mémoire mirifique qui prend comme Icare son envol: «Je sais bien que l’aube viendra, mais où aller/avec la part de pénombre encore présente/qui nous est échue; qui nous crédite l’un et l’autre» (p.63).
Nissabouri est un poète de l’errance, décomposé dans l’univers. Il est dans un entre-deux, «entre soi et ce qui persiste encore / d’une noce de miracles -il y a / là-bas un cantique nomade / avec son quotient de hasards / d’azur et de dehors aériens» (p.96).
Les vers sont modernes, sans versification ni ponctuation précise (on pense bien sûr au pionnier du vers libre, Guillaume Apollinaire). Le lecteur se délectera dans les ruines nissabouriennes qui se font contrepoids, se jaugent comme des rivaux, font l’amour dans l’œuvre épique peut-être la plus flamboyante du poète.
Mais la fin de cette histoire, me demanderiez-vous? Voici: un personnage —féminin — nommé la Voyageuse apparait dans la trame et nous entraine vers le Sud du Royaume, dans des dunes mouvantes, une géologie si pure et les terres de l’avenir. On y rencontre les forces célestes et terrestres de l’éternel Sahara marocain. C’est là-bas dans le désert que conduit la pérégrination de la poésie ultime, comme un hymne de vers épiques à la patrie qui exalte le minéral et le grain des pierres immobiles dans le temps, célébrant la beauté de l’univers qui noue ses noces avec le pays du poète: «Une perception érotique manifeste dans la désignation des lieux de l’espace saharien (…) et ce corps est un corps féminin» (p.168).
Lire aussi : Fedwa Misk: «J’ai écrit “Des femmes guettant l’annonce” pour mon pays»
Mostafa Nissabouri, un esprit libre, difficile à classer, explorant dans ses écrits les spécificités du psychisme marocain, les relations entre les cultures et les langues arabes et françaises, les tensions entre héritage traditionnel et modernité. Né en 1943, il restera l’un des auteurs les plus représentatifs et brillants de la poésie maghrébine de langue française. Ses œuvres poétiques de jeunesse ont été publiées principalement dans les revues marocaines militantes «Souffles» (1966) et «Intégral» (1971), dans lesquelles il joua un rôle fondamental, deux dates clés de l’histoire littéraire du pays où l’on retrouve en chevilles ouvrières un certain Abdellatif Laâbi et le regretté Mohammed Khaïr-Eddine, notamment dans la première, «Souffles», interdite au Maroc dès 1972, car jugée dangereuse par le pouvoir à l’époque. Avec Abdelkebir Khatibi, Tahar Ben Jelloun et d’autres, Mostafa Nissabouri a contribué à créer l’espace culturel propice au renouveau de la littérature dans le Maroc contemporain.
Ses anthologies ont été traduites en langue anglaise (États-Unis) et arabe (Maroc). Le poète a publié notamment en France chez les éditions Al Manar des compilations de ses poèmes: «Approche du désertique» (1997 et 1998), et notamment trois recueils fort bien accueillis par la critique: «La mille et deuxième nuit» (1975) (en hommage à un conte fantastique de Théophile Gautier), «Rupture» (1982) et «Aube» (1999) un portfolio accompagné de sérigraphies de l’artiste Farid Belkahia.
Qui aime les mots de la langue — des «balles», disait Sartre — se verra obsédé par ce texte à la fantasmagorie puissante. À lire absolument.
«La variable poétique en premier». 196 pages. Éditions Omnia, 2024. Prix public 90 DH.