Kamel Daoud: «Pour comprendre l’Algérie profonde, celle que cache le pays Potemkine des clichés, il faut lire le délicieux roman policier de Saïd Khatibi» (Le Point). Ce conseil propose aussitôt un double horizon de lecture: le polar, et ce qu’il dévoile en creux.
L’intrigue s’ancre en septembre 1988, dans une petite ville aux portes du désert algérien où gronde une révolte larvée. La population, accablée par une invasion de criquets et une pénurie alimentaire, survit dans un climat d’angoisse diffuse. Dans ce décor, l’on découvre le corps de Zakia Zaghouani, dite Zaza, danseuse de cabaret morte près de l’hôtel où elle se produisait. Ainsi s’ouvre l’énigme de ce roman, publié en mars 2025 dans la prestigieuse collection «Série Noire» de Gallimard.
Le lecteur est aussitôt entraîné dans un récit éclaté, construit comme un puzzle où chaque pièce est livrée par la mémoire et la subjectivité des personnages. Le fiancé Bachir, vite soupçonné et jeté en prison par un inspecteur jaloux secrètement amoureux de Zaza, mais aussi le patron de l’hôtel, le veilleur de nuit, le gérant d’un vidéoclub aux mœurs étranges et bien d’autres voix dessinent une polyphonie rugueuse faite de rancunes, regrets et demi-vérités.
Or l’enquête est un prétexte et ne cherche pas spécialement à trouver le coupable. Personne dans la petite ville ne semble vraiment assoiffé de justice ou de vérité absolue; chacun cherche surtout à sauver sa peau ou celle d’un proche, voire à tirer profit de la situation. Saïd Khatibi utilise les codes du roman noir pour ausculter, sans concessions, les plaies de la société algérienne à un moment charnière de son histoire. Les destins individuels illustrent les fractures d’un pays. Le lecteur passe ainsi de la cellule d’un commissariat crasseux à l’arrière-salle enfumée d’un cabaret, d’une cour de maison écrasée de soleil où une mère en deuil jette des ordures en marmonnant des malédictions, aux rues poussiéreuses envahies de jeunes chômeurs désœuvrés. Ce théâtre humain donne à voir l’envers du décor de la société.
De quel «Sahara» parle le roman?
Le titre, La fin du Sahara, agit comme une énigme à lui seul. Pris au sens littéral, il évoque la fermeture de l’hôtel Le Sahara où travaillait Zakia. Mais très vite, il se déploie comme un symbole plus vaste: celui du tarissement d’un imaginaire national. À la surface, il désigne la fin d’un lieu de sociabilité; en profondeur, il suggère l’effondrement d’un mythe collectif.
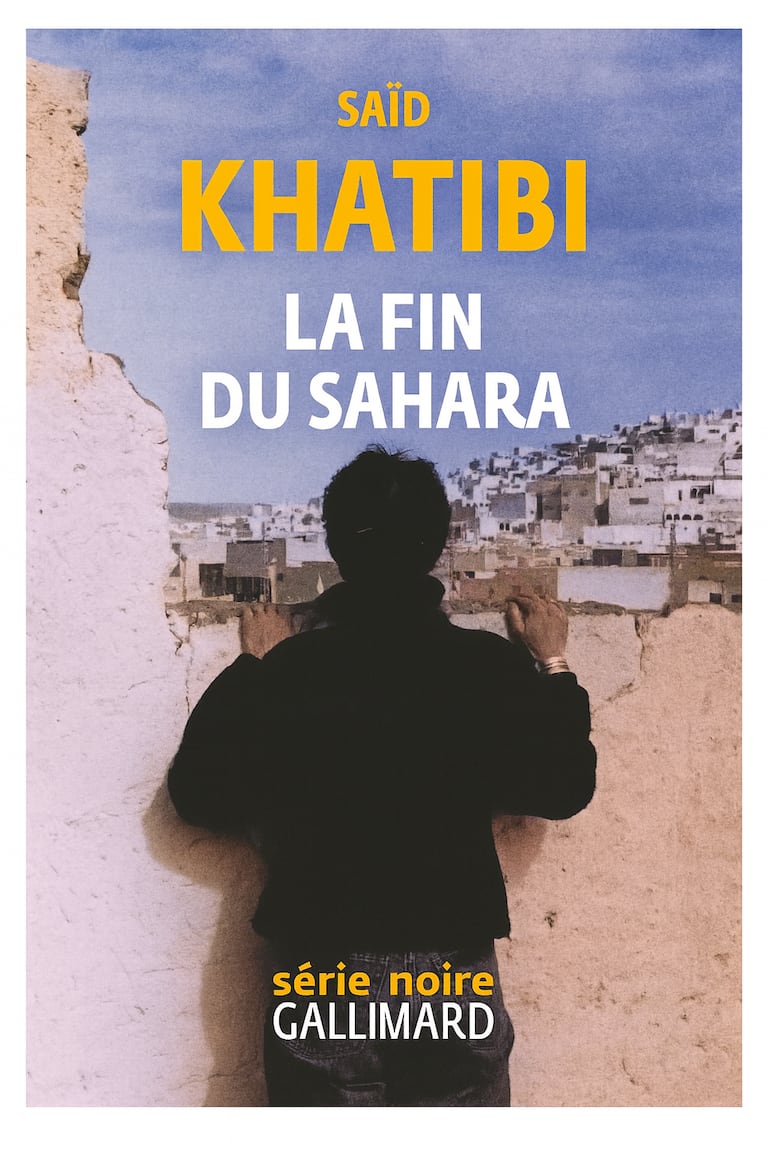
Cette fin du monde est double. Elle dit d’abord l’Algérie de 1988, prélude à la décennie noire, sur laquelle s’étale le récit, comme un écran de fumée dans lequel s’engloutissent les illusions politiques. Puis elle ouvre sur une métaphore contemporaine: celle de l’Algérie de 2025, prise au piège du conflit saharien. Le roman superpose ainsi deux temporalités – le passé et le présent – pour en faire un second livre dans le livre, où la culbute finale se joue au Sahara dit occidental. Baisser le rideau, clap de fin, implosion du pays: l’épuisement d’une terre minée par le conflit. Le game over d’une illusion nationale.
L’allégorie traverse la mécanique narrative: chaque scène semble orientée vers cette interrogation centrale. Le Sahara devient le miroir d’un vide politique. Le mot fin consacre la décomposition d’un ordre ancien, l’épuisement d’un récit héroïque qui tournait en rond. Tout le monde qu’il charriait: illusions, transactions, faux-semblants. Ce fil rouge, tendu dès le titre, guide la lecture: il éclaire l’énigme policière, innerve la chronique sociale et la mémoire historique vers un point de fuite unique: l’idée d’une fin de l’Algérie à travers l’affaire du Sahara.
Le poids de l’histoire et des non-dits
«La fin du Sahara» se déploie sur quarante jours d’enquête. Ce temps court entre en résonance avec l’Histoire algérienne. Khatibi choisit une période charnière: les semaines qui précèdent les émeutes d’octobre 1988, ces soulèvements populaires contre le régime du FLN. Le roman épouse le rythme d’un deuil national et juxtapose deux dynamiques: l’avancée de l’enquête criminelle et la montée des tensions sociales. Derrière la recherche du meurtrier, la ville gronde: queues interminables pour du pain ou de la semoule, rancunes contre des autorités incapables d’endiguer les nuées de criquets dévorant les récoltes. L’un des habitants résume, désabusé: «L’État a échoué à éradiquer les criquets qui ont envahi les fermes avoisinantes. – Une année de sécheresse et de maigre récolte, commente l’un. – (patience, ça passera), dis-je…» Mais rien ne passe, tout s’envenime.
Certains voient dans ces catastrophes une punition divine: «La canicule et les criquets, Dieu veut-il nous punir?» s’inquiète un villageois, alors que «le ciel n’a pas craché son eau depuis six mois». La sécheresse s’installe, les pénuries s’aggravent, et l’air lui-même devient combustible. Peu à peu, la ville se transforme en poudrière.
Khatibi excelle à rendre sensible ce climat crépusculaire. «Tous les bâtiments de cette ville… sont désormais envahis de fer et de sauterelles», note amèrement un personnage. Le fer dit la militarisation rampante; les sauterelles, la prolifération du malheur. Chaque détail quotidien s’articule pour décrire une Algérie au bord de la rupture.
L’ombre de 1962
L’indépendance de 1962 continue de hanter les personnages les plus âgés. Trois décennies plus tard, les blessures ne sont toujours pas refermées. Khatibi met en lumière la manière dont le passé héroïque a été confisqué par les récits officiels, alors que la réalité présente révèle d’anciens vainqueurs déchus, compromis ou corrompus. Le roman exhume des collaborations occultées, des règlements de comptes étouffés, des figures d’hier transformées en opportunistes aujourd’hui. Ces non-dits historiques s’entrelacent avec l’enquête, comme si le meurtre de Zakia n’était qu’un prolongement des drames anciens.
L’assassinat de la jeune femme plonge en effet ses racines dans les secrets de la génération précédente, celle de ses parents. Dans une ville où «chacun cache des secrets, dans une communauté où tout le monde se connaît». Chaque destin individuel devient l’écho d’une mémoire collective manipulée. L’auteur interroge ainsi cette mémoire biaisée, recomposée par le pouvoir, mais toujours agissante dans le quotidien des personnages.
La révélation du meurtrier porte elle aussi la marque de cette dimension politique. Car Zakia n’était pas seulement une chanteuse innocente: elle avait de multiples amants, détenait un secret compromettant et usait du chantage pour tenter d’assurer son avenir. «Une fille déçue par son amant… et une chanteuse qui, meurtrie dans son âme et son corps, recourt au chantage d’un assassin pour s’en sortir». Ce portrait cruel dépasse l’individu: il devient l’allégorie d’un pays brisé, où la corruption, la trahison et les blessures du passé continuent de miner le présent.
Un style entre réalisme cru et virtuosité poétique
Sur le plan de l’écriture, le roman en près de 400 pages, se distingue par une langue foisonnante, à la fois dense et vibrante, magnifiée par la traduction de l’arabe de Lotfi Nia. Les dialogues, pleins de gouaille algérien, côtoient des envolées poétiques, mais aussi des insertions de prose sèche, presque journalistique: extraits de rapports de police, coupures de presse glissées dans le récit, journal de prison. Cette variété de registres reflète le talent de Khatibi pour mêler le réalisme le plus cru à une virtuosité lyrique. Journaliste de formation, il sait documenter son contexte avec précision, mais il ne se prive jamais d’y faire passer le souffle de la littérature.
L’épilogue résonne comme un voile jeté sur la lumière: Le polar n’était qu’un passe, la parabole a tenu la lampe. Tout au long du récit, le désert du titre a glissé du paysage à l’idée, de la topographie au symbole, structurant la lecture comme une ligne de fuite invisible. Et si la question initiale – de quel Sahara parle le roman? – continue de vibrer, c’est qu’elle a trouvé sa réponse la plus convaincante: celle qui unit l’hôtel qui ferme, la ville qui suffoque, l’histoire qui se venge et le pays qui se raconte une dernière fois, juste avant que ne monte la nuit.
Saïd Khatibi vit en exil en Slovaquie.
«La fin du Sahara», Saïd Khatibi, traduit de l’arabe par Lotfi Nia, 400 pages. Editions Gallimard, collection Série Noire, 2025. Disponible en pré-commande dans les librairies.












