L’héroïne, Fajr, Aube, 25 ans, possède des «yeux à la couleur rare, or et vert, comme le paradis» (p.15). C’est une femme muette qui a été égorgée durant la guerre civile, mais n’en est pas morte. Elle est enceinte d’une fille qu’elle veut prénommer Houri: «Dans la lumière, j’apparais comme une femme de taille élancée, exténuée, à peine vivante, et mon immense sourire figé ajoute au malaise de ceux qui me croisent. Ce sourire, illimité, large, presque dix-sept centimètres, n’a pas bougé depuis plus de vingt ans» (p.16). Ce gros rire ininterrompu est une éternelle «cicatrice» qui s’étire sur le visage «monstrueux». L’écriture est ardente et percutante, mêlant des instants de pure beauté à d’autres d’une intensité presque insupportable.
Kamel Daoud nous livre un voyage au bout de l’enfer, à la fois violent et poétique. Cependant, il finit dans le paradoxe du nom de son héroïne, Aube. Elle porte en elle la promesse d’un renouveau, la résilience intérieure et la possible renaissance d’un peuple meurtri par la terreur. Le roman s’attache à dévoiler une vérité plus profonde: celle d’une amnésie collective organisée, imposée par un régime cherchant à effacer les traces de cette décennie de sang, de peur et de trahisons. Les cicatrices de cette guerre civile restent ouvertes, mais on les cache sous une chape de silence, comme si le simple fait de ne pas en parler suffisait à les guérir. C’est cette amnésie que Kamel Daoud met en lumière. Au contraire, cette mémoire refoulée devra un jour éclater au grand jour, sous une clarté rédemptrice qui balaiera les ombres de l’oubli.
L’avenir d’Aube est lié à deux récits, l’un sur la décision d’avorter ou pas, et elle entame alors un monologue émouvant destiné à Houri dans son ventre, pour accoucher finalement de sa propre histoire. L’autre récit, descriptif et extérieur, se transforme en quête essentielle, un voyage dangereux vers les lieux de son enfance, le village Had Chekala, où à l’âge de 5 ans elle a vécu l’horreur. Sa famille fut décimée et elle laissée pour morte par les «barbus». Mais ce monologue est précédé d’un vrai article juridique algérien, repris en partie par l’auteur, une loi de 2015 qui prévoit de trois à cinq ans de prison pour quiconque parle en public des années de guerre. Cette charte du «silence» des années Bouteflika, qui stipule par ailleurs que toute plainte de citoyen se doit d’être jugée irrecevable par les juges, pompeusement appelée «politique de réconciliation», a plutôt provoqué une «amnésie sociale» (p.59). Elle confère une gravité au message qu’adresse la mère à son enfant. Elle se fait, pour la fille qui pousse dans son ventre, la narratrice sans voix de cette tragédie devenue le grand tabou de l’Algérie. Aube lui dévoile ses tourments, ses souvenirs et les batailles qu’elle a menées pour s’émanciper du joug des hommes.
Ainsi le personnage attachant de Hamra, vierge kidnappée par les terroristes, mariée de force à un combattant puis à un second après la mort du premier, lui dira: «Je souhaite, ma sœur, que tu obtiennes des droits pour nous, les femmes violentées, les femmes enceintes sans père, les accusées» (p.69). Hamra, mille fois violée, transmue son amie de peine Aube en une Marianne ou une Olympe de Gouges.
Ce roman jette un regard implacable sur l’islamisme et les ravages qu’il sème dans la société algérienne. Elle chuchote à son enfant: «Retourne au paradis. C’est de là que tu viens, n’est-ce pas? De ce lieu qui fait saliver les hommes et pour lequel ils s’entretuent. Son parfum se sent à soixante-dix ans de marche, a raconté l’imam de la mosquée voisine. Ma Houri, écoute mon conseil de mère tueuse! Regagne ta tente faite d’une seule perle creuse, comme l’imam le répète aux fidèles» (p.211). Ce huis clos entre la mère et l’enfant permet la traversée d’un temps de guerre suspendu au malheur, à la terreur, comme si l’histoire devait se graver dans des livres enfin, s’accrocher quelque part après vingt ans de silence assourdissant. Comme Aube s’accroche à l’espoir.
Daoud, avec sa plume incisive et lyrique, montre que l’avenir de l’Algérie ne se résume pas à une fatalité de souffrance et de secret. Il invite à croire en une résurrection, non seulement individuelle, à travers ses personnages, mais aussi collective. La véritable guerre qu’il dépeint est celle de la mémoire, une bataille intérieure où chaque Algérien devra affronter ses fantômes pour espérer une renaissance. Ce roman n’est pas seulement une descente aux enfers, mais l’histoire d’une espérance fragile et tenace, celle d’un peuple qui, malgré tout, cherche la lumière au bout du tunnel.
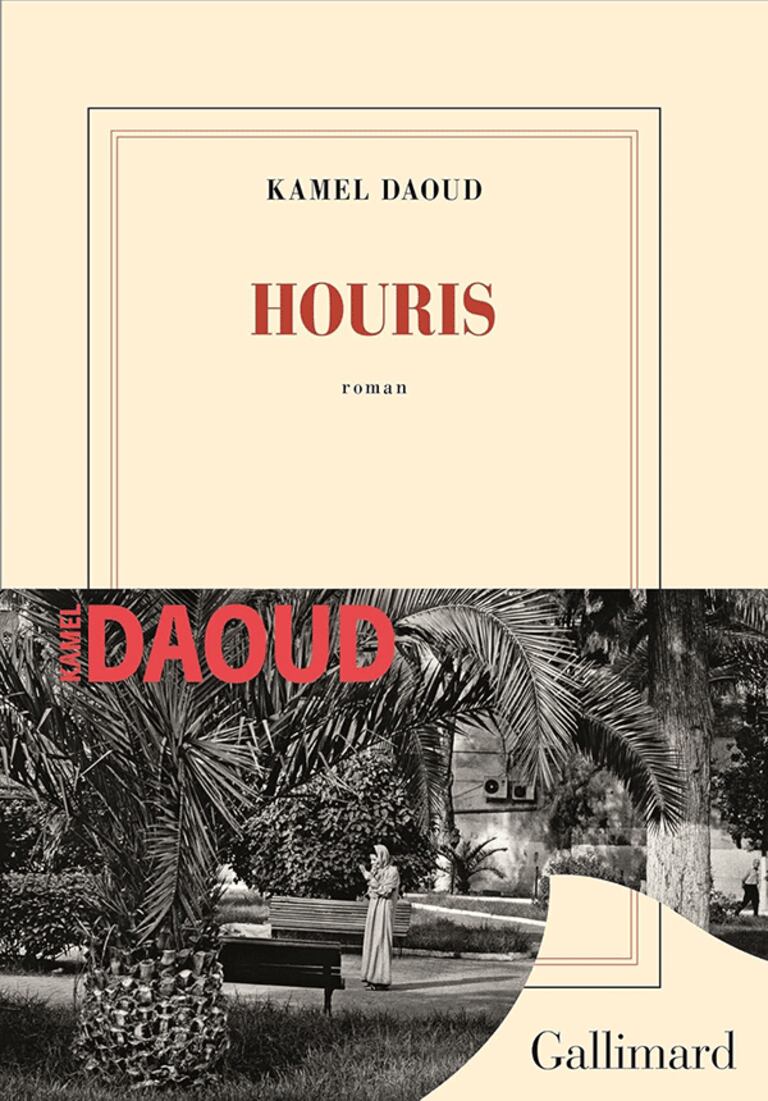
Un autre symbole clé de Kamel Daoud est l’enseigne du commerce d’Aube, dont elle est si fière: «Salon de coiffure Shéhérazade». Le salon «provoquait les regards réprobateurs de la mosquée voisine» (p.36), jusqu’à devenir un objet de rébellion. Il y aura 1.001 morts en une nuit, c’est le bilan du massacre de Had Chekala, autant que le nombre de récits dans le conte arabe. Shéhérazade, c’est aussi demeurer en vie, nuit après nuit, histoire après histoire, grâce à la prise de parole. Aube entraîne alors son bébé dans un voyage vers son village natal, à la poursuite des spectres de son enfance. Un périple étonnant dans un monde mi-réel, mi-halluciné de l’histoire de ce pays.
Les Algériens portent en eux un passé lourd de silence, enfoui au plus profond de leur conscience collective, qui demeure tapi dans l’ombre, inexprimé, mais omniprésent. La guerre civile qui a ravagé le pays entre 1992 et 2002, a fait plus de 200.000 morts, laissant des traces profondes et ineffaçables. Ces violences extrêmes ont été refoulées par un peuple tout entier, contraint de se taire sous le poids d’une répression étatique et d’un traumatisme. C’est un passé que l’on préfère oublier, mais dont les cicatrices sont visibles dans la galerie des personnages qui gravite autour de l’héroïne.
C’est dans ce contexte que la littérature joue un rôle crucial, en abordant l’intime, là où les documents historiques ne parviennent pas à s’aventurer. Alors que les archives officielles des pays ne racontent que les faits, les romans dévoilent les émotions, les peurs et les blessures intérieures. À l’image de «L’Archipel du Goulag», d’Alexandre Soljenitsyne, qui a mis en lumière l’horreur du stalinisme, ou de «Moi le suprême», d’Augusto Roa Bastos, qui a magistralement capturé l’essence des dictatures d’Amérique latine des années 1970, l’Algérie contemporaine trouve désormais son propre miroir dans «Houris», de Kamel Daoud. Ce roman éclaire la «démocrature» algérienne, ce régime hybride où les libertés sont à la fois promises et écrasées.
À travers la fiction, Daoud donne une voix à ce passé refoulé, à ces mémoires oubliées et montre l’impact dévastateur de cette violence intériorisée sur l’individu et la société. En s’attaquant aux tabous de l’histoire récente de l’Algérie, il révèle les douleurs psychologiques non résolues qui rongent le peuple algérien, faisant de «Houris» bien plus qu’un simple roman: un divan de la parole.
Témoigner du sort des femmes durant la décennie noire, période de cruautés extrêmes en Algérie, représente un risque immense, pouvant conduire à la prison à vie. En Algérie, parler publiquement des exactions islamistes ou de l’oppression des femmes demeure un acte de bravoure, souvent réprimé par les autorités. Kamel Daoud, écrivain engagé, a dû fuir son pays pour la France afin de publier ce roman bouleversant, qui dénonce ces réalités avec une rare audace. Son œuvre, à la fois corrosive et profondément humaine, lui vaut une reconnaissance internationale, notamment avec le prix Goncourt du premier roman en 2015, pour «Meursault, contre-enquête». En 2020, il devient citoyen français, un tournant marquant dans sa vie d’intellectuel exilé, et continue de porter, depuis l’Hexagone, un regard incisif sur l’Algérie.
«Houris», 310 pages. Éditions Gallimard, 2024. Prix public: 300 DH.









