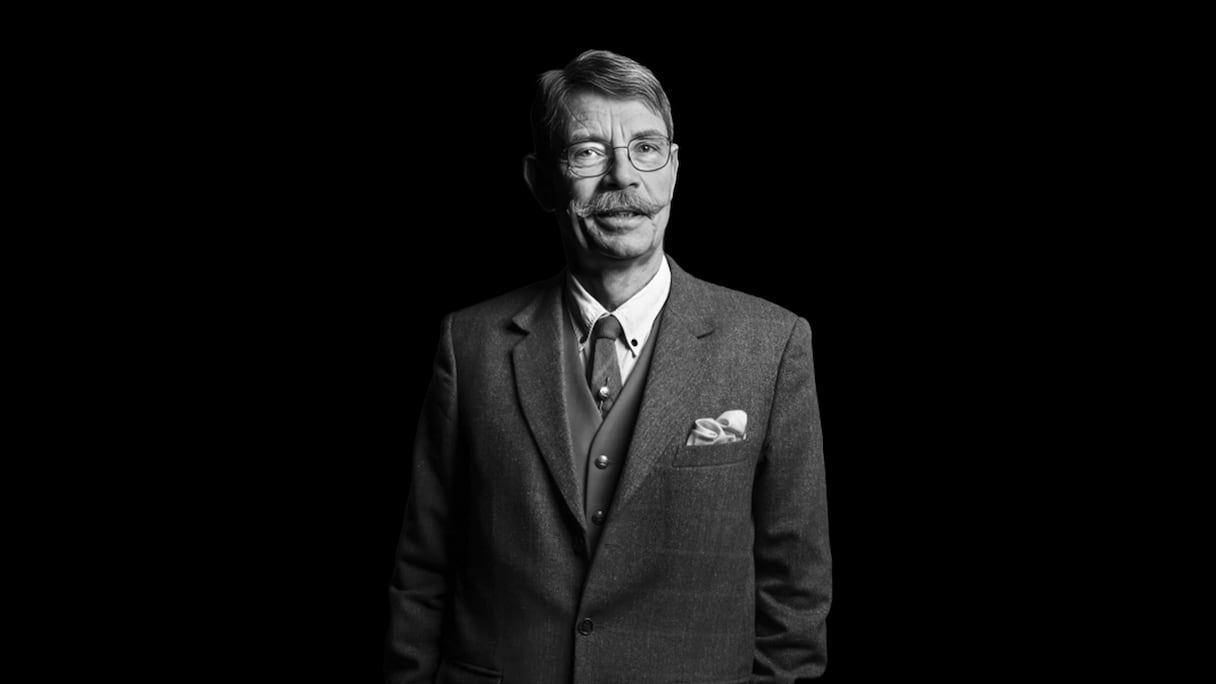Au Sahel, à de petits noyaux de religieux convaincus sont venus s’agréger tout ce que la région compte de trafiquants, de mécontents, de bandits traditionnels, de coupeurs de route, d’orpailleurs, de braconniers et d’éleveurs dont les troupeaux sont razziés.
En arrière-plan de leur engagement se trouvent des facteurs lourds comme la démographie, l’opposition ethno-raciale ou la question politique résultant de l’ethno-mathématique électorale. Nous sommes également le plus souvent en présence de jeunes en rupture dans une sorte de révolte des cadets contre les anciens. Ces rebelles sortent ainsi de leur soumission institutionnelle et du statut qui en est la résultante par la possession d’une arme et d’un salaire qui leur permet de contourner l’impossibilité de constituer la dot permettant le mariage. En plus de cela, nous assistons à la revanche des délaissés des périphéries ethniques.
Plus qu’un authentique jihad, nous serions donc là en présence d’une véritable révolution culturelle mettant à bas le soubassement des cultures africaines, à savoir la hiérarchie des classes d’âge.
Dans son rapport du 12 juin 2018, Crisis Group a ainsi synthétisé la question en écrivant que:
«La frontière entre le combattant jihadiste, le bandit armé et celui qui prend les armes pour défendre sa communauté est floue. Faire l’économie de cette distinction revient à ranger dans la catégorie «jihadiste» un vivier d’hommes en armes qui gagnerait au contraire à être traité différemment» (Crisis, 2018:17).
Certains parmi ces chefs se veulent les héritiers du jihadisme pan-peul précolonial de l’empire de Sokoto qui contrôlait un immense territoire s’étendant du Macina malien au nord du Burkina Faso et jusqu’à la Centrafrique. Entre les chefs de ces GAT (Groupes armés terroristes) et les recrues locales, les buts n’étant pas communs, la question est de savoir jusqu’à quand ils seront obéis, car leur stratégie est en contradiction avec les motivations de leurs hommes. Là se trouve très exactement la faille dans laquelle doit s’engouffrer la contre-insurrection.
Les responsables de ces GAT ont-ils d’ailleurs une stratégie ou bien agissent-ils par simple opportunisme? Là encore, la réponse est difficile à donner. Pour le moment, le conflit n’a pas «coagulé». Ce jihad, qui a pour but la fondation d’un califat trans-ethnique, a en effet buté sur la réalité ethnique car les énormes fossés séparant les protagonistes ont jusqu’à présent empêché l’engerbage. Le jihadisme régional se trouve donc pris au piège des rivalités ethno-centrées qui constituent la vraie réalité sociologique régionale.
Sommes-nous face à la reprise du grand mouvement de poussée de certains peuples sahéliens vers l’Océan, mouvement qui avait été bloqué par la colonisation et qui renaîtrait donc aujourd’hui sous paravent islamique et à la faveur de la déliquescence des États?
Quoi qu’il en soit, en dépit de ses causes endogènes, la question s’inscrit clairement dans un cadre sous-régional englobant le Mali, le Niger, le nord de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin. Or, dans toutes ces régions, le soubassement de la dislocation est formé par la résurgence active ou potentielle de conflits ethniques antérieurs à la période coloniale. Renaissant sous forme de querelles paysannes amplifiées par la surpopulation ainsi que par la péjoration climatique, ils entrent ensuite dans le champ du jihad.