«La Naturalisation» (Grasset, janvier 2025) conjugue avec force plusieurs grands thèmes liés à l’exil et à l’identité. Le romancier y dépeint le parcours rocambolesque en France d’Elyas Z’Beybi, un jeune Tunisien empli de rêves parisiens et littéraires. Le lecteur découvre un personnage à la fois naïf et attachant, dont le nom, qui signifie «le solitaire» dans le parler potache, condense toute l’ambiguïté de sa destinée: à la fois marqué par une obstination intime et condamné à rejouer sans cesse l’expérience de la marginalité. Cette solitude se double d’une autre: l’omniprésence de la sexualité, fil rouge du roman, qui agit comme un révélateur des manques, des frustrations et des illusions d’Elyas.
Le prologue s’ouvre sur une scène fondatrice en Tunisie: la circoncision du héros, rite de passage douloureux, coïncide avec la chute du président Bourguiba. La mémoire familiale a retenu ce moment comme un signe historique, un double arrachement, intime et national. «La mémoire de ma mère est formelle: au lendemain de ma circoncision difficile, Bourguiba, notre petit père à nous, n’était plus.» Par cette concordance entre le corps et l’Histoire, Zied Bakir noue dès l’entrée un destin marqué par le traumatisme et la dépossession. Plus tard, les flashbacks rappellent l’enfance du narrateur, laissant dans son être la trace d’un doute existentiel, une parenthèse identitaire jamais refermée.
Face à cet héritage ambigu, Elyas décide de quitter sa terre natale. Son choix n’est pas seulement un départ géographique, mais une tentative de renaissance: il veut, dit-il, «se fondre» dans une France rêvée, nourrie par les fantasmes littéraires et l’imaginaire parisien. Son départ prend la forme d’un vœu de rupture radicale: «Je partirai, je ne changerai pas le monde, je changerai de monde, comme ça sur un coup de coude.» Derrière la légèreté apparente de la formule se cache toute la gravité d’un destin qui bascule. La quête d’Elyas se déploie dans l’horizon incertain d’un ailleurs à inventer. Entre deux mondes, ni tout à fait tunisien, ni jamais pleinement français, il demeure ce «solitaire» dont la naturalisation n’est pas une délivrance, mais un exil redoublé.
Un Candide moderne au pays des illusions
Le voyage du héros prend la forme d’une œuvre burlesque, où chaque étape vire à l’absurde. Arrivé en France, le cœur débordant d’amour pour le pays, Elyas n’est encore qu’un puceau. Son obsession devient rapidement sexuelle, un loup dans une bergerie découvrant l’amour auprès d’une fille de joie rencontrée rue Saint-Denis. Puis, parce que les femmes le trouvent «pas mal», il enchaîne les aventures comme on collectionne des trophées.
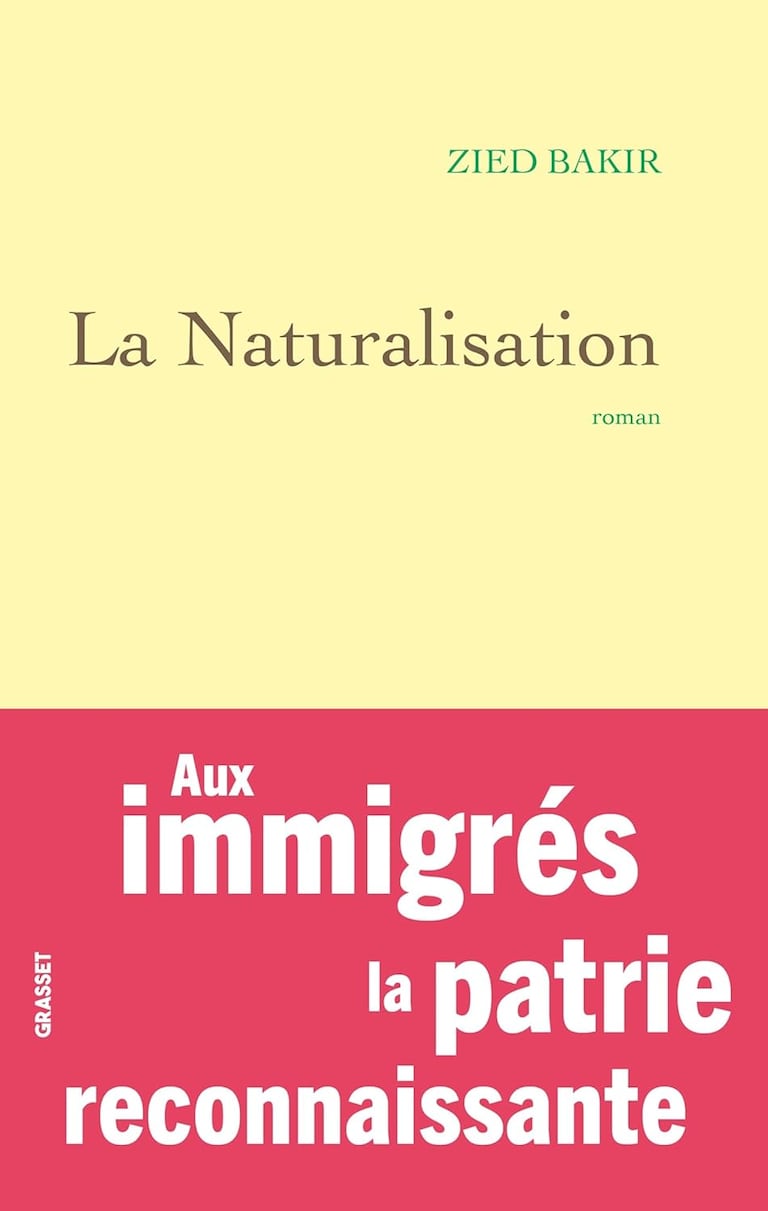
Accroc au sexe, il en oublie l’essentiel. Sa réputation s’effondre à l’université, notamment auprès de sa directrice de thèse, et bientôt il se retrouve… dans la rue. L’enlisement commence: Elyas rejoint la cohorte des sans-abri et partage le quotidien des clochards parisiens et des voyous de la nuit. Même les compagnons d’Emmaüs, censés incarner la solidarité, apparaissent sous sa plume comme une «multinationale du pauvre».
L’insensé culmine lorsqu’il s’engage dans la Légion étrangère — LEGIO PATRIA NOSTRA — où l’héroïsme se résume à la devise: «Servir la France c’est servir l’humanité». De fil en aiguille, l’humour noir se mue en satire sociale, déconstruisant les illusions et dénonçant l’inhumanité du monde moderne, où «Paris n’est pas un paradis pour tout le monde». Son itinéraire farcesque le conduit jusqu’à l’asile psychiatrique, où il se retrouve interné. Même dans cet antre de la folie, sa psychiatre française, Adeline, s’éprend de lui et de son «Quasimodo» - sobriquet donné par le narrateur à son intimité corporelle - avant d’aller jusqu’à lui demander sa main.
Le texte plante ainsi le décor d’une lente et fatale perte de l’appartenance culturelle: la dissolution du moi de l’immigré. L’absurdité des bureaucraties rencontrées - dossiers de naturalisation, files d’attente à l’asile - fait écho à un malaise plus général: le narrateur aspire au droit élémentaire d’être reconnu. À chaque étape, il bute sur des frontières invisibles, qu’elles soient sociales, légales ou culturelles, qui résistent à son intégration.
Lire aussi : Parution. «La fin du Sahara» de Saïd Khatibi, un polar algérien entre énigme criminelle et parabole politique
Le texte interroge crûment les notions d’assimilation et de mérite républicain dans la France contemporaine. «Qu’est-ce que l’identité nationale française ?» demande en filigrane le narrateur. Zied Bakir ne fournit pas de réponses faciles; il donne à voir, avec une ironie sombre, la dignité fragile de ceux qu’il nomme les «tombés du monde», condamnés à inventer une place dans une société qui les refuse. L’histoire avance d’un pas hésitant, à la manière d’un Candide moderne, oscillant entre la dérision et l’amertume.
La littérature comme exorcisme et miroir du monde
Sur le plan littéraire, l’écrivain renouvelle le thème d’exil par un ton inédit. L’œuvre alterne comédie truculente et méditation sérieuse, trouvant un équilibre subtil entre dialogues percutants et passages introspectifs. La dimension métatextuelle est omniprésente: l’écriture elle-même devient un thème, puisque Elyas est doctorant en littérature médiévale, et la posture du narrateur rappelle que raconter son vécu est déjà un acte salvateur. Sous forme d’autofiction, le roman revendique la puissance du récit comme moyen de survie. Le protagoniste compare son écriture à une exorcisation intérieure. Il rédige des «notes pour se débarrasser de soi» et insiste: «sur le papier, seulement sur le papier», comme si l’encre seule pouvait digérer les traumatismes et les transformer en arabesques. À mesure que le dérisoire du quotidien s’efface surgit le questionnement métaphysique: Elyas contemple «le ciel sans piliers visibles», allusion énigmatique à un besoin de spiritualité qui hante tout le livre. Confronté à la question de son but ultime, il énonce en une formule cartésienne définitive: «Je suis, donc j’écris. J’écris, donc je suis», scellant l’identité par l’écriture comme une thérapie littéraire.
Le conflit culturel occupe également une place centrale. L’héritage d’Elyas fait resurgir les poids du passé: il décrit le système scolaire tunisien comme un lieu où l’arriération cohabite avec un savoir figé. Il fustige l’idéologie bourguibiste, pleine de contradictions, et la modernisation factice qui a davantage engendré des frustrés qu’émanciper une société. Son amour pour la France n’efface pas ses limites: Elyas demeure prisonnier de son fonds arabo-musulman et de traditions auxquelles il reste attaché.
Cette voix narrative singulière – à la fois narcissique et généreuse – est servie par un style visuel, rythmé, traversé de jeux de mots et d’allusions littéraires. Le romancier convoque Brassens, Shéhérazade, mais aussi l’Histoire universelle, élargissant sans cesse l’horizon de l’écriture. Cette ambition quasi encyclopédique nourrit un texte qui prétend embrasser le monde contemporain dans sa complexité. Dans ce dispositif, la caricature vulgaire agit comme une arme double : un rire corrosif, mais aussi un stratagème pour transmettre des vérités difficiles.
En quête d’humanité
«La Naturalisation» s’affirme comme un roman coup de poing sur l’exil moderne, un texte qui dialogue sans détour avec l’actualité française. À la critique acerbe des institutions et des mentalités répondent gags, quiproquos et situations grotesques, autant de séquences qui minent l’idée même d’une intégration fluide dans la société d’accueil. Pour le lecteur, l’histoire résonne au plus profond des débats contemporains: Zied Bakir met en scène l’expérience d’un migrant qui ne recherche pas seulement un statut juridique, mais une identité authentique, une place stable dans une France qui se questionne sur ses origines. L’ouvrage révèle en creux l’échec récurrent de la naturalisation pour une partie de la diaspora nord-africaine, dont l’itinéraire oscille entre rêves d’insertion et désillusions amères.
Le style fait preuve d’une inventivité constante. L’argot de la rue côtoie un français soutenu, des expressions arabes s’insinuent dans le tissu narratif, et l’ensemble produit une langue hybride, éclatée, à l’image du héros. Ce brassage linguistique, enrichi de références littéraires et musicales – des Mille et une Nuits à la chanson française – accentue le caractère fantasque. L’auteur parvient à maintenir un équilibre fragile: comique permanent d’un côté, souffrance la plus vive de l’autre.
Mais au-delà de la satire, c’est une invitation à l’empathie qui s’esquisse. Par sa fragilité et l’ambivalence de ses choix, d’Elyas pousse à réécrire nos récits collectifs, à reconsidérer la place des «exclus» dans la mémoire commune. La trame propose ainsi une vision à la fois mordante et profondément humaine du monde contemporain. Par sa force critique et sa dimension existentielle, il renouvelle avec éclat le roman maghrébin d’expression française qui interroge l’identité tout en la réinventant. Une parabole contemporaine où le grotesque et le tragique avancent main dans la main. Derrière la drôlerie des situations et la drôlerie acide des dialogues, se dessine une interrogation universelle: qu’est-ce que «devenir quelqu’un» dans un monde qui vous rejette sans cesse à la marge? Elyas condense les espoirs, les illusions et les désillusions de toute une génération en quête de reconnaissance. Si la France apparaît dans l’ouvrage comme une patrie rêvée qui se transforme rapidement en machine à exclure, la Tunisie, elle, reste une terre d’origine trop lourde, encombrée d’un héritage idéologique stérile. Pris entre ces deux pôles, Elyas ne trouve refuge que dans l’écriture, son dernier territoire possible.
En ce sens, le roman ne se contente pas de dénoncer l’échec de la naturalisation administrative: il met en lumière l’échec plus profond du voyage existentiel, celui qui devrait permettre à un individu d’habiter pleinement un lieu, une langue, une histoire. Loin des slogans politiques, ce texte rappelle que l’exil est moins un déplacement géographique qu’une fracture intime. Et qu’au bout du compte, l’unique appartenance d’Elyas – et peut-être de tout écrivain – demeure la littérature elle-même.
Sur l’auteur
«La Naturalisation» s’inscrit dans une trajectoire déjà amorcée. Zied Bakir avait publié «On n’est jamais mieux que chez les autres» en 2012 (Éd. Erick Bonnier), un premier roman autoproduit qu’il vendait dans les rues de Saint-Germain-des-Prés, marqué par la même énergie critique. En 2021, il rejoint Grasset avec «L’amour des choses invisibles», un texte plus intime où l’on retrouve déjà son obsession pour la mémoire. Son œuvre porte les grandes interrogations de la diaspora maghrébine: l’assimilation, la Tunisie postcoloniale, la quête de reconnaissance. Chez l’auteur, l’écriture devient une patrie à part entière.
«La Naturalisation», Zied Bakir, 208 pages. Éditions Grasset, 2025. En précommande dans les librairies.












