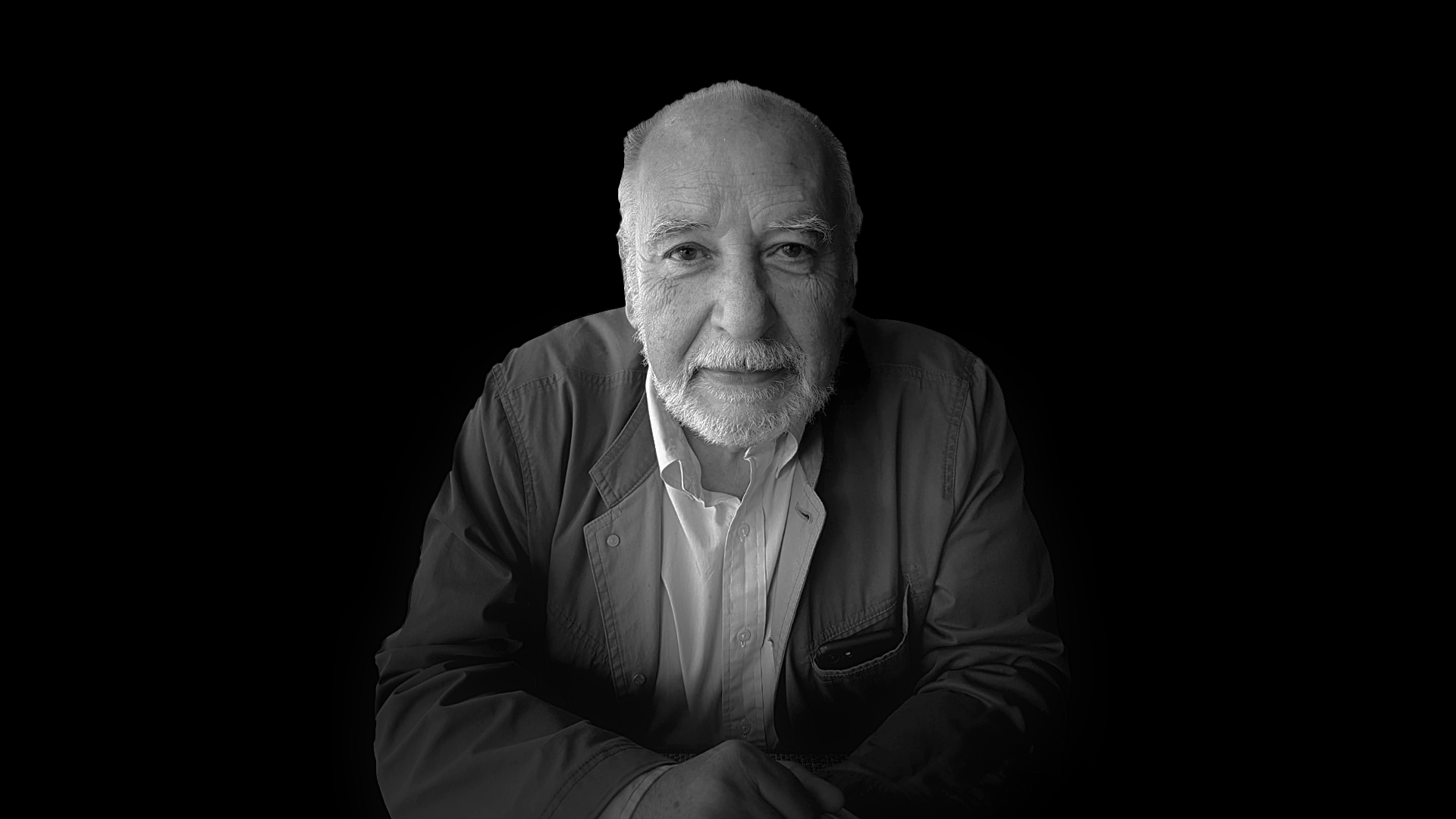Je lis une information sur l’Algérie parue en première page du Figaro du 27 septembre 2023: «Interdiction d’autres manuels que ceux du programme d’État. Limitation des heures de français, durcissement de l’accès aux universités algériennes pour les titulaires du bac français, interdiction aux candidats libres de passer l’examen au lycée français. Bouleversant la rentrée, le ministère de l’Éducation intensifie la chasse au « double programme » dans les écoles privées. Les directeurs d’école doivent renoncer au programme français sous peine de poursuites pénales».
C’est avec ce gouvernement que le président français compte en finir avec «la rente mémorielle».
Parmi les romans qui se sont distingués en cette rentrée littéraire en France se trouvent trois ouvrages écrits par des Marocains: «Adieu Tanger» (Éditions Grasset), de la très jeune Salma El Moumni, et «Les silences des pères» (Le Seuil), de notre ami Rachid Benzine. Tous les deux figurent sur des listes des grands prix de l’automne. Quant à «À la recherche de Glitter Faraday», de Kebir M. Ammi (Éditions Project’îles), c’est un roman formidable, malheureusement passé inaperçu auprès des jurys des prix.
Écrits dans un français impeccable, ces livres, au-delà de leur sujet, illustrent et célèbrent la langue française qui n’appartient à personne. Le français est parlé par davantage de non-Français dans le monde. Mais la question est ailleurs: une langue, surtout quand on l’a apprise enfant, quand elle a fait partie de notre construction mentale, ne doit pas être insultée, boycottée, mise à l’écart, condamnée et interdite.
Toute langue mérite le respect. Toute langue mérite d’être apprise. Plus on connaît de langues, mieux on comprend le monde et sa complexité.
Nous aurions pu parler en anglais, si le protectorat avait été britannique. Mais l’histoire est ainsi. Nous prenons ce «butin de guerre», d’après la célèbre expression du grand poète algérien Kateb Yacine, et nous en faisons de belles choses.
Le roman de Salma El Moumni (originaire de Tanger, elle a fait l’École normale supérieure à Lyon) est émouvant. Une adolescente parle du regard que posent sur elle les hommes, elle évoque son monde intérieur et découvre combien la littérature est une chance pour s’émanciper. Elle se prend en photo, pensant qu’elle seule les regarde. Mais elles passent sur Internet. La suite ressemble à la vie de la jeune auteure. L’adolescente part faire des études à Lyon, avec la peur que ces photos dévoilées lui causent un grand tort. Elle devient paranoïaque et a peur de revenir au pays. Salma El Moumni donne une voix à celles qui se sentent seules et incomprises.
Rachid Benzine, après «Ainsi parlait ma mère» (2020), évoque son père dont il apprend la mort par téléphone. C’est dire que les relations entre les deux hommes n’étaient pas très bonnes. Il revient à Trappes, sa ville d’enfance, et là, il tombe sur une grande quantité de cassettes audio où le père raconte sa vie en France, une vie «pleine de trous et de chagrin», dans le Nord et les banlieues, à Besançon et autres lieux.
Ce père qui ne parlait pas a laissé un long message qui dit une vie et son malheur.
Il fut un moment où des immigrés illettrés envoyaient des cassettes enregistrées à leur famille restée au pays. Le père du narrateur ne les envoyait pas, mais les gardait dans un coin. C’est le point de départ d’un roman original, bien composé et très touchant.
Livre émouvant, bref et surtout vrai. On sent que Rachid, même s’il a inventé l’histoire des cassettes (dans la vie, son père a laissé trois cassettes seulement), a fait le voyage dans le long parcours d’un père qui trimait et ne disait rien.
Rachid s’interroge sur les silences de ce père, ce qui donne le sens du roman: «Peut-être que la parole arrache brutalement au silence ce qu’il a gagné lentement. Et le galvaude à jamais. Et si le silence était notre dernier espace de liberté? Là où s’appréhende notre savoir, ce que nous avons appris de l’existence. Se taire pour accéder au vrai, au beau, au juste?»
Rachid est un pédagogue, un bon connaisseur de la pensée islamique, un homme de paix et de partage à l’instar de son ami, le prêtre Christian Delorme, qui l’a aidé et encouragé à aller de l’avant. C’est un intellectuel qui ne la ramène pas. Il est connu pour sa modestie. Son roman donne la parole à une génération de travailleurs immigrés dont certains ont été ensevelis dans un linceul de silence.
Kebir Ammi nous emmène en Amérique, et par ricochet à Alger, à l’époque où s’y tenait le grand festival panafricain. C’était au moment où les Américains marchaient sur la lune. 1969. Glitter Faraday était là ainsi que les Black Panthers. Une époque faste et extraordinaire. Un manuscrit aurait été emporté par ce jeune noir exalté. Plus de quarante ans plus tard, le narrateur part à la recherche et de l’homme et du manuscrit. Ce qui nous vaut un voyage dans une Amérique peu banale, avec des personnages extravagants, sortis d’un vieux film des années cinquante et d’une musique d’Archie Shepp.
Roman passionnant, étonnant, tout nouveau dans les thèmes et leurs traitements dans la littérature d’expression française. Je suis certain que Kateb Yacine aurait aimé cette échappée dans les territoires d’une Amérique dont la mémoire est meurtrie par tant de malheurs.
Et puis il y a Alger «où tout commence et tout s’achève». Un roman ample et magnifique qui nous éloigne des clichés de cette littérature maghrébine qui se sent parfois obligée de passer par la case autobiographie pour exister.