Une nuit de l’an 1997. Dans un village perché sur les hauteurs d’Alger, l’accalmie est brutalement rompue par l’arrivée d’une jeep. Ce qui semblait être une patrouille militaire se transforme en cauchemar pour la famille de Selma qui est de passage dans le hameau: haches et sabres surgissent du véhicule, et les râles des victimes déchirent la nuit paisible. Selma, l’héroïne du récit, âgée de 21 ans, devient le témoin impuissant de ce massacre: «Ses jambes tremblaient et son cœur battait si fort qu’il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Elle connaissait le mot, dhabahine, les égorgeurs. Dhabahine, dhabahine!»
Le mystère de la présence de Selma dans ce modeste village de Sidi Youcef, loin des quartiers cossus de Hammamet où elle réside habituellement, ne se dévoile qu’à la fin du roman. En attendant, le lecteur est plongé dans les méandres d’une Algérie en proie à la guerre civile, entre violence omniprésente et survie quotidienne.
Une famille à secrets
Dans ce contexte de guerre, le roman nous invite à découvrir l’intimité d’une riche famille algérienne habitant une ancienne villa coloniale. Le père de Selma, Brahim, récemment promu chef du service de pédiatrie à l’hôpital de Baïnem, partage son foyer avec Zyneb, son épouse, et sa fille. Les tensions ne manquent pas dans cette maison où Zyneb entretient une relation difficile avec sa belle-mère Mima, qui occupe le premier étage du manoir. Hicham, frère cadet de Brahim, vit quant à lui dans des «combles réaménagés après des travaux mal faits parce que mal payés à des ouvriers maliens sans papiers», une place marginale dans une famille qui l’a relégué en périphérie tandis que les autres disposent des étages.
Ce Hicham, diplômé en droit, mais sans emploi, nourrit une amertume grandissante qui le conduit dans les filets de l’islamisme radical. Devenu un disciple de Ali Benhadj, le gourou co-fondateur du Front islamique du salut (FIS) algérien, qui appelle aux armes dans les mosquées, il incarne la dérive de cette jeunesse désabusée et laissée pour compte. L’univers familial en apparence paisible est en réalité fissuré, comme l’Algérie.
La plongée dans l’effroi
Ces vies se voient progressivement emportées dans la tourmente des événements politiques qui ont marqué le pays. Le roman s’inscrit dans une période de basculement dans une violence systémique, où la frontière entre l’intime et le collectif s’efface sous l’impact de la guerre civile. L’auteure rend palpable l’atmosphère oppressante d’une société au bord de l’implosion. La montée des tensions sociales, catalysée par les grèves massives et les manifestations, fait émerger une colère populaire longtemps contenue. Les rues d’Alger et des autres grandes villes deviennent des champs de bataille où les revendications politiques et économiques se heurtent à une répression brutale: «Les heurts-incendies de bâtiments publics, attaques de voitures de police au cocktail Molotov, fusillades, égorgements se multipliaient dans le pays.»
Le roman ne se contente pas de décrire ces événements comme un arrière-plan historique. Les grèves massives perturbent la vie des personnages, tandis que les manifestations violentes deviennent des points de rupture où leurs existences basculent. La répression policière, avec ses rafles arbitraires et sa violence aveugle, pénètre jusque dans les foyers, brisant les repères et exacerbant les tensions familiales. Chaque personnage porte les stigmates de cette période: Brahim se noie dans son travail pour échapper à une réalité oppressante, Hicham cède aux sirènes de l’islamisme radical, tandis que Selma tente désespérément de trouver un refuge dans sa passion pour les chevaux.
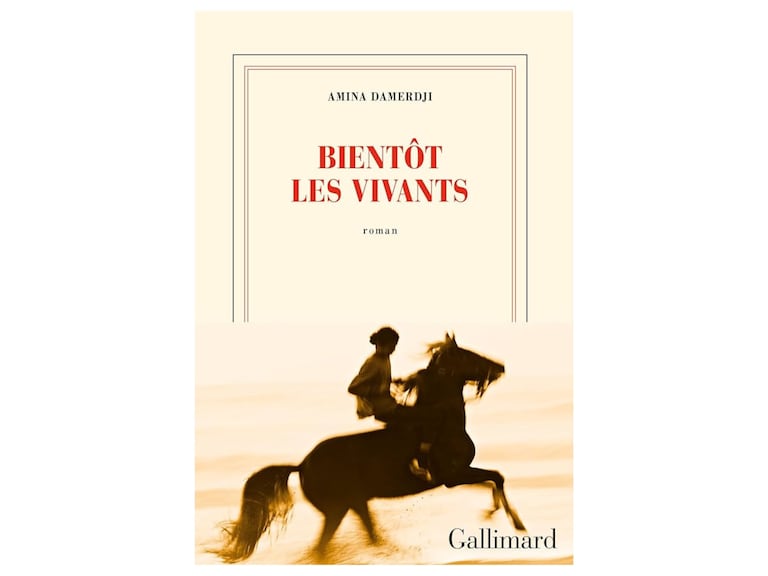
Dans l’intime, la méfiance devient un mode de survie, les regards se détournent, les voix se taisent. Les habitants apprennent à se taire dans une société où la dénonciation, les disparitions forcées et les exécutions sommaires sont devenues monnaie courante. Cette atmosphère d’étouffement et de paranoïa imprègne chaque page, reflétant la manière dont la grande Histoire envahit les vies individuelles: «Le silence était coupé par des coups de feu lointains, presque fantomatiques. Dans la maison, personne n’osait allumer la lumière. Selma, recroquevillée sous une couverture, fixait le plafond. Le bruit des tirs semblait se rapprocher, s’intensifier, jusqu’à devenir un martèlement sourd contre ses tempes.»
Sans aucune indulgence, cet ouvrage dévoile sans fard la barbarie des deux camps opposés. Hicham, marqué à jamais par les tortures subies durant son incarcération, porte un fardeau indicible qu’il ne peut partager, encore moins avec sa jeune nièce adolescente: «Avouer qu’on l’avait contraint à boire l’urine écumeuse des soldats? Évoquer la plaie suppurante à son anus, qui lui arrachait des hurlements à chaque tentative de s’asseoir sur la cuvette?»
Du traumatisme à la rédemption sociale
Amina Damerdji accorde une attention particulière aux portraits des deux comparses, Maya et Selma, dont les destins se croisent dans un équilibre fragile entre rébellion et sensibilité. Maya, l’aînée, s’affirme en photographe intrépide pour un journal, incarnant l’esprit rebelle face à un monde en mutation. Elle côtoiera la frayeur. Selma, plus douce et introspective, consacre ses efforts à apprivoiser Sheïtane, une jument rétive et traumatisée par les mauvais traitements de son ancien maître. Promis à l’abattoir en raison de son comportement imprévisible, l’animal trouve en Selma une alliée patiente et déterminée, qui tente avec tendresse de briser la carapace forgée par la brutalité des palefreniers, eux-mêmes prompts à surnommer la jument «Satan»: «Soudain, elle lâcha les rênes. Sheïtane hésita puis comprit. Il s’élança. Ses crins noirs voletèrent. Le soleil dessinait des reflets acajou sur son encolure. Selma se dressa sur ses étriers. Le vent défit sa natte et, tandis que les mèches lui fouettaient les joues, elle plissa les paupières. Elle laissa Sheïtane accélérer jusqu’à ce que le bruit de ses sabots ne soit plus qu’un staccato sur le sable et la mer une rayure bleue grisante.»
L’amour que Selma porte aux chevaux, la liberté qu’elle ressent lorsqu’elle chevauche dans la nature deviennent des actes de résistance silencieuse. Ce lien puissant entre l’adolescente et l’animal incarne une lumière dans les ténèbres, un rappel que, même au milieu des ruines, il est possible de panser les plaies et de reconstruire: «Elle laissa Sheïtane galoper, le vent s’engouffrant dans ses cheveux défaits. À cet instant, elle se sentit libre, légère, comme si le monde autour d’elle n’était qu’un souvenir effacé par la vitesse.»
Au cœur des turbulences historiques, Selma incarne une forme de résilience. L’Algérie est un animal blessé: «Raser le contour des plaies, les laver à l’eau savonneuse, appliquer des compresses désinfectantes puis pommader, masser jusqu’à l’absorption complète de la crème cicatrisante.» Cette vocation naissante reflète sa détermination à offrir une seconde chance à cet animal que tout condamnait. Les soins qu’elle lui prodigue interviennent quand tout semble brisé.
Le (faux) schéma de la réussite: l’oncle Charef, une bulle érotique
Dans cette famille hypertrophiée par la Décennie noire, il y a le père de Maya, Charef Hakkar, incarnation d’une réussite éclatante, tant sociale que financière. Il loge sa famille dans un somptueux palais ottoman au cœur d’Alger, élégamment restauré et équipé des plus modernes commodités. À travers une démonstration ostentatoire de richesse, il couvre ses proches de présents somptueux, tentant de consolider un bonheur fragile.
Pourtant, derrière cette façade éclatante, une angoisse latente l’habite: la peur viscérale de perdre Souad, sa jeune épouse à la beauté ensorcelante. Le masque d’opulence qui alimente la jalousie de son entourage cache un homme en proie à des tourments intérieurs, constamment ébranlé par des doutes sur sa propre valeur: «C’est qu’il n’en revenait toujours pas. Lui, Charef le laid, Charef au visage si disgracieux que les enfants se moquaient de lui dans la rue. Charef le gros, l’obèse qu’on appelait patapouf ou bibendum derrière son dos à la piscine, avait épousé une des femmes les plus courtisées de la ville.»
L’Histoire et l’intime, un jeu d’échos
En 288 pages, ce roman se distingue par sa capacité à entrelacer les destins individuels et les bouleversements historiques. Les trajectoires de Selma, Zyneb, Hicham, Maya, Charef et des autres membres de cette famille brisée deviennent les miroirs d’une Algérie devenue folle. Chaque personnage porte en lui les stigmates de la guerre civile, que ce soit à travers le poids des choix moraux, les traumatismes physiques ou l’érosion des liens familiaux. Plus qu’un simple témoignage historique, le roman interroge la capacité des individus à se reconstruire, à trouver des fragments de lumière dans l’obscurité, et à continuer de croire en la vie, malgré tout.
Amina Damerdji a publié, en 2021, son premier roman «Laissez-moi vous rejoindre» (éd. Gallimard), l’histoire de Haydée Santamaria, une Cubaine qui a lutté aux côtés de Fidel Castro et qui s’est donné la mort en 1980. À découvrir… «Bientôt les vivants» est son deuxième roman, salué par la critique. Il a remporté le Prix de la littérature arabe des lycéens, ainsi que le Prix Transfuge en 2024.
«Bientôt les vivants», de Amina Damerdji, 288 pages. Éditions Gallimard, 2024. Prix public: 280 DH.









