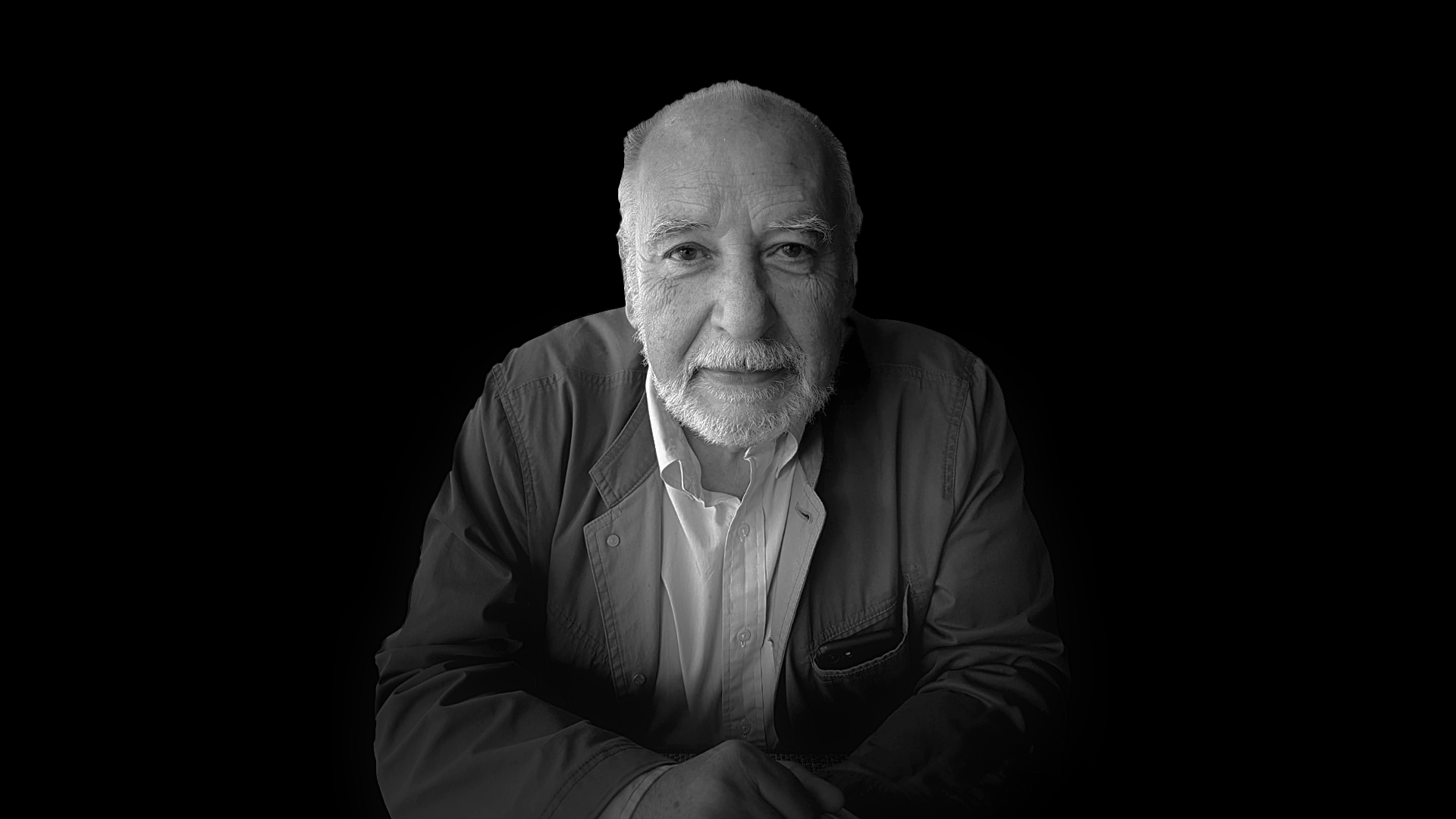J’aime ce lieu, resté le même, avec son horloge arrêtée, ses canapés en cuir marron fatigués et ses serveurs qui ont vieilli avec lui.
Il m’arrive souvent de m’y installer, de commander un thé et de regarder les gens aller et venir. Je fais mon métier d’écrivain. Observateur, scrutateur, un peu voyeur. Il y a ceux qui montent de la médina, d’autres qui prennent le chemin de la Casbah et du quartier Marshan. C’est un lieu central, au croisement du Tanger européen et de la vieille médina.
Aujourd’hui, ce café ressemble à un petit musée vivant.
Ce fut là que je rencontrais, au début des années soixante-dix, Jean Genet, Roland Barthes, Juan Goytisolo, Allen Ginsberg, Mohamed Choukri, etc. Aujourd’hui, je n’y vois que des hommes d’un certain âge, seuls ou en groupe, en train de regarder le spectacle de la vie.
Dans l’incontournable «Tanger, réalités d’un mythe», Rachid Tafersiti nous rappelle que ce fut dans ce café que l’Américain Tenesse Wiliams et l’espagnol Antonio Munoz Molina venaient chercher l’inspiration, ou tout simplement regarder les gens passer. Le dramaturge américain a écrit la pièce (devenue ensuite un film) «Soudain l’été dernier» dans un petit hôtel nommé Djenina, se trouvant dans une montée à partir de l’avenue d’Espagne.
On pourrait ajouter la fréquentation du Gran Café de Paris par Francis Bacon et son ami, le peintre marocain Ahmed Yacoubi. On raconte qu’ils auraient réalisé une toile commune que personne n’a vue et qui n’existe peut-être pas. Cela fait partie de la mythologie de cette cité qui vécut sous le statut de ville internationale jusqu’en 1956.
L’autre jour, assis au Gran Café de Paris, j’ai assisté à une scène digne d’un drame théâtral. Une mendiante, en jellaba, la quarantaine, demande sur un ton misérable l’aumône à un automobiliste qui attendait sa femme, descendue acheter un médicament à la pharmacie qui jouxte le café. Il lui dit: «Désolé, je n’ai pas de monnaie». Elle insiste. Il lui répète qu’il ne peut pas lui donner l’aumône et qu’Allah l’aidera à vivre. La mendiante, de faible et misérable, change de ton et se met à l’insulter avec une rage qui a choqué les clients du café: «Pourquoi ne veux-tu pas sortir ton argent? Tu vas mourir, avec ta belle voiture, tu auras un accident et là tu verras que ton argent ne te sauvera pas de la mort…»
Agression caractérisée. L’automobiliste est resté sous le choc. Il n’a pas répondu. Sa femme l’a rejoint et il est parti laissant derrière lui la mendiante qui continuait à prier Dieu pour qu’il le punisse.
Ce genre d’agression est de plus en plus fréquent, m’a-t-on dit. Certains pauvres réagissent violemment. On ne sait pas s’ils sont des mendiants professionnels ou de véritables pauvres sans le sou. Ce problème existe partout dans le pays. Ni la wilaya ni le gouvernement ne lui ont trouvé de solution.
Je traverse Place de France et pars vers la rue du Mexique. Dans un coin, un bouquiniste. La boutique est immense, remplie de vieux magazines, de journaux de l’autre siècle, de bouquins de toute sorte. Rien n’est classé. Il faut fouiller, aller chercher sous un tas de livres, peut-être l’essai ou le roman qui me ferait plaisir.
Le propriétaire, la quarantaine est assis et lit un Paris-Match des années soixante. Il sourit. Il visite le passé à travers des revues qui évoquaient un monde qu’il ne connaît pas. Je lui demande pourquoi les livres ne sont pas rangés. Il pousse un soupir, lève les bras et me dit: «Mais mon ami, les Marocains ne lisent plus! J’ai ici des livres pour tous les goûts. Là, il y a les bouquins pour « mieux être », le bonheur en quelques leçons; ça, ça marche un peu. Là, j’ai plusieurs éditions du Coran. J’ai des collectionneurs qui viennent l’acheter. Mais le reste, les romans, les essais, personne n’en veut.»
Je tombe sur «Ainsi parlait Zarathoustra», le chef-d’œuvre de Nietzsche; à côté, une biographie de Freud et certains de ses écrits; là, des livres en allemand, d’autres en anglais américain. Il me dit: «Nietzsche, ce n’est quand même pas rien! Personne ne le veut. Je l’ai mis en évidence, espérant qu’un étudiant en philo l’achète, rien, non, ça n’intéresse personne. Il en est de même de Freud, pourtant notre société aurait besoin de le lire…»
Je pars en lui promettant de parler de sa boutique. Il y a des gens qui aiment chiner, fouiner et acheter de très vieux bouquins. Cela, c’est aussi le Tanger d’avant.
Je me dirige vers le boulevard Pasteur. Je m’arrête devant la fameuse librairie des Colonnes qui fait partie de l’histoire et de la mythologie de Tanger. Elle avait appartenu à Gallimard dans les années cinquante ou soixante. Elle a été dirigée par deux femmes venues de Belgique. Ce fut la plus belle époque.
À leur retraite, la vendeuse, Rachel, celle qu’on appelait «la mémoire de Tanger», prit la suite. Gallimard a vendu la librairie.
Période trouble jusqu’à l’arrivée de Pierre Bergé qui la rachète et essaie de la remonter. À sa mort, son héritier, Madison Cox, la revend à un homme d’affaires marocain qui, malheureusement décède peu de temps après. Ses enfants voulurent la remettre sur pied. Mais l’esprit n’y est plus.
Ils la revendent à un groupe de Français et à un Marocain pour un prix symbolique. Les dettes sont importantes. Le groupe essaie depuis deux ans de trouver un sponsor pour payer les dettes et investir dans la librairie. Depuis, plus rien. On attend. La vieille dame de Tanger est presque vide. On attend un miracle.
Cette librairie devrait être sauvée. Elle est l’une des mémoires de Tanger. Dommage de la laisser mourir dans l’oubli.
Je descends vers l’ancien port; je prends la pente qui passe par le Gran Teatro Cervantes. Ce théâtre, qui date du début du siècle dernier (1913), est enfin en train d’être restauré. L’espoir est permis d’en faire quelque chose de beau et d’important pour la culture.
Les travaux sont immenses. La petite kissaria a été détruite. On la reconstruit. On attend de voir ce que va devenir ce quartier qui a longtemps été l’assemblée générale des rats de la ville basse et de la ville haute.
Je descends vers l’avenue d’Espagne. De vieux immeubles à l’architecture baroque sont repeints. En face, c’est le début de la marina. Et ça, c’est le Tanger nouveau. Chic et choc. Du fric et du spectacle.
Un jour, j’irai plus loin découvrir ce Tanger qui ne fait plus rêver les poètes, les musiciens et les cinéastes.