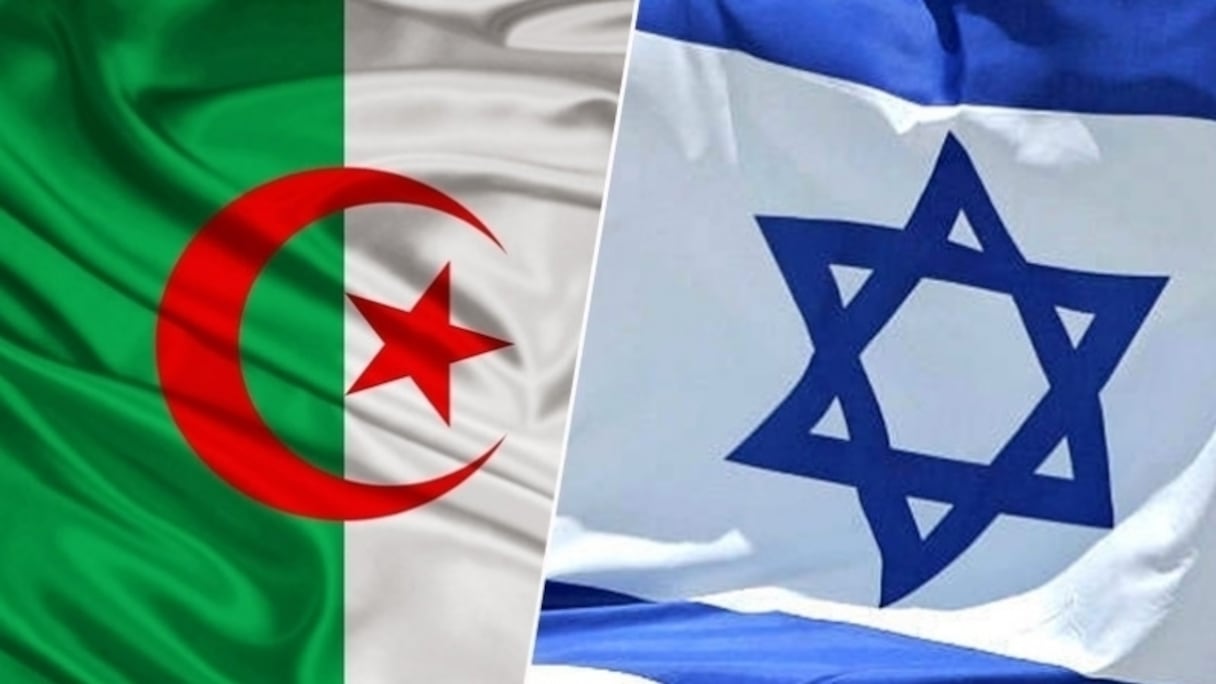L’Algérie, sous la poigne des généraux, est un pays fondamentalement anormal et même «hors normes», dans le sens le plus négatif du terme. Il n’a ni la distance, ni le recul, ni la sérénité, ni la sagesse et encore moins la compétence pour juger de ce qui est normal et de ce qui ne l’est pas, surtout concernant les relations internationales.
La posture adoptée par la junte est pour le moins hypocrite, comme si les États arabes étaient indifférents au sort des Palestiniens. Son refus de toute normalisation avec «l’entité sioniste» (sic) dissimule également des motivations antisémites bien identifiées et documentées chez les généraux.
L’inéluctable chemin vers la paix
Malgré les violences et les résistances des extrémistes des deux bords, les hommes de paix, israéliens et arabes, font de leur mieux pour résorber les méfiances et apaiser les inquiétudes. Ils poursuivent sans relâche leurs efforts, convaincus que la voie de la paix passe par une solution à deux États, vivant en paix dans des frontières sûres et reconnues.
Parmi ces efforts, rappelons le plan arabe de paix adopté en 1982 à Fès, la conférence de Madrid de 1991, les accords d’Oslo de 1993, le sommet de Camp David en 2000. Et aussi l’importante «Initiative de paix arabe» adoptée lors du Sommet de la Ligue arabe à Beyrouth en 2002. Elle a été adoptée à nouveau en 2007, sans modification, lors du sommet de Ryad.
Cette initiative de paix, qui a proposé d’améliorer les relations avec Israël, le retour de cet État aux frontières de 1967 et la création d’un État palestinien avec Jérusalem Est comme capitale, a été favorablement accueilli par l’Autorité palestinienne. L’Algérie, qui a visiblement la mémoire courte, a également voté pour cette initiative, en 2002 comme en 2007.
Le débat s’était engagé au sujet de l’amélioration (ou normalisation) des relations avec Israël, interrogeant s’il fallait l’entamer avant ou après la création de l’Etat palestinien.
Partant du principe que la création d’un État palestinien était inéluctable, la normalisation a été considérée comme un signe de bonne volonté et un bras tendu adressés aux camps de la paix en Israël et à ses alliés occidentaux.
L’inquiétude sur la pérennité d’Israël, qui hante la mémoire collective du peuple juif, devait être apaisée. La normalisation des relations s’inscrit dans un élan de paix bénéfique pour les deux peuples. Rien n’a été entrepris au détriment des Palestiniens!
Des traités de paix ont été signés par Israël avec l’Égypte (1979) et la Jordanie (1994). Ont suivi d’autres traités, d’une nouvelle génération, inscrits dans le cadre des Accords d’Abraham, qui priorisent le développement et la prospérité économique partagés.
Les premiers ont été signés en septembre 2020 entre Israël d’une part, et les Émirats Arabes Unis et Bahreïn de l’autre. Dans ce même cadre, un traité de paix a été signé entre Israël et le Soudan en janvier 2021.
Lors des négociations préalables, la question palestinienne est toujours restée le background et le levier principal motivant l’action des pays arabes signataires de ces accords de paix, afin de trouver un règlement juste à ce conflit.
La communauté israélienne d’origine marocaine fortement attachée à ses racines
En décembre 2020, le Maroc, les États-Unis et Israël ont signé un accord tripartite dans le cadre des Accords d’Abraham. Cet accord a ouvert de grandes perspectives de coopération politique, diplomatique et économique entre les trois pays.
Or, étant donné que près d’un million de citoyens israéliens sont d’origine marocaine, la notion de «normalisation» doit être nuancée dans le cas du Maroc.
Les Accords d’Abraham ont en effet un caractère particulier pour le Maroc et Israël. Au-delà des équations politiques et diplomatiques, des liens humains, socio-culturels et historiques ont été «rétablis» avec la communauté israélienne d’origine marocaine. Des liens qui n’ont jamais été totalement rompus, car cette communauté est restée culturellement et émotionnellement très attachée au Royaume, terre de ses ancêtres.
Tous les observateurs estiment que les valeurs portées par le Maroc -terre de cohabitation heureuse des religions- qui imprègnent également le judaïsme marocain contribueront à l’instauration de la paix. Loin des envolées mystiques et illuminées des uns et des slogans creux et des exploitations politiques des autres, seul le réalisme et le pragmatisme, dans le cadre d’un règlement juste et équitable, mèneront à la paix. D’ailleurs, d’autres signatures de traités de paix entre Israël et des pays arabes sont se préparent.
Les Israéliens sont exténués de gérer ce sentiment de vivre dans une citadelle assiégée. Ils savent aussi que l’emploi de la force ne réglera rien. De leur côté, les pays arabes reconnaissent à Israël le droit à l’existence et à la sécurité, aux cotés d’un État palestinien viable et indépendant.
Les faiseurs de paix et les semeurs de haine
Pendant que les bonnes volontés, des deux côtés, cherchent à construire des ponts et des passerelles, les généraux algériens ont eu l’idée ridicule de déployer une propagande insensée autour d’un projet de loi «incriminant la normalisation avec l’entité sioniste». Comme par hasard, ce projet de loi a surgi deux semaines après la signature de l’accord tripartite le Maroc, les États-Unis et Israël.
En janvier 2022, la junte a ordonné à 50 députés (issus du bourrage des urnes) de soumettre un projet de loi interdisant «d’établir des contacts ou des relations ou d’ouvrir des bureaux de représentation avec l’entité sioniste». Le texte interdit également de «voyager à destination et en provenance de l’entité sioniste», ainsi qu’aux «titulaires de la nationalité de cette entité d’entrer sur le sol algérien…». Avec ces mesures dérisoires et absurdes, les dirigeants algériens pensent-ils contribuent à trouver une solution au conflit?
Ce délirium législatif n’a finalement pas dépassé le stade du projet. Car, bien évidemment, il faut toujours faire un distinguo entre la réalité des actes et les slogans creux du régime algérien.
Le pays du «monde à l’envers»
Le système politico-militaire algérien, lui-même anormal, atypique, opaque, illisible et indéchiffrable, devrait d’abord «normaliser» ses relations avec son propre peuple, qu’il ne cesse de brutaliser depuis 1962.
Qu’il normalise d’abord ses relations avec les familles des victimes et des disparus de la décennie noire. Qu’il mette en œuvre un processus de justice transitionnelle. Qu’il normalise la vie politique avec des institutions crédibles, des partis politiques représentatifs et libère les énergies d’une société civile asphyxiée.
Qu’il «normalise» son économie, captive de la rente pétrolière, et qu’il l’intègre dans l’économie d’un monde globalisé. Qu’il normalise aussi ses relations avec les pays voisins du Maghreb, du Sahel et du reste de l’Afrique, contre lesquels il ne cesse de comploter.
Le chemin est très long et la liste est infinie de ce que doit «normaliser» un État déstructuré pour retrouver un peu de crédibilité au sein de la communauté internationale.