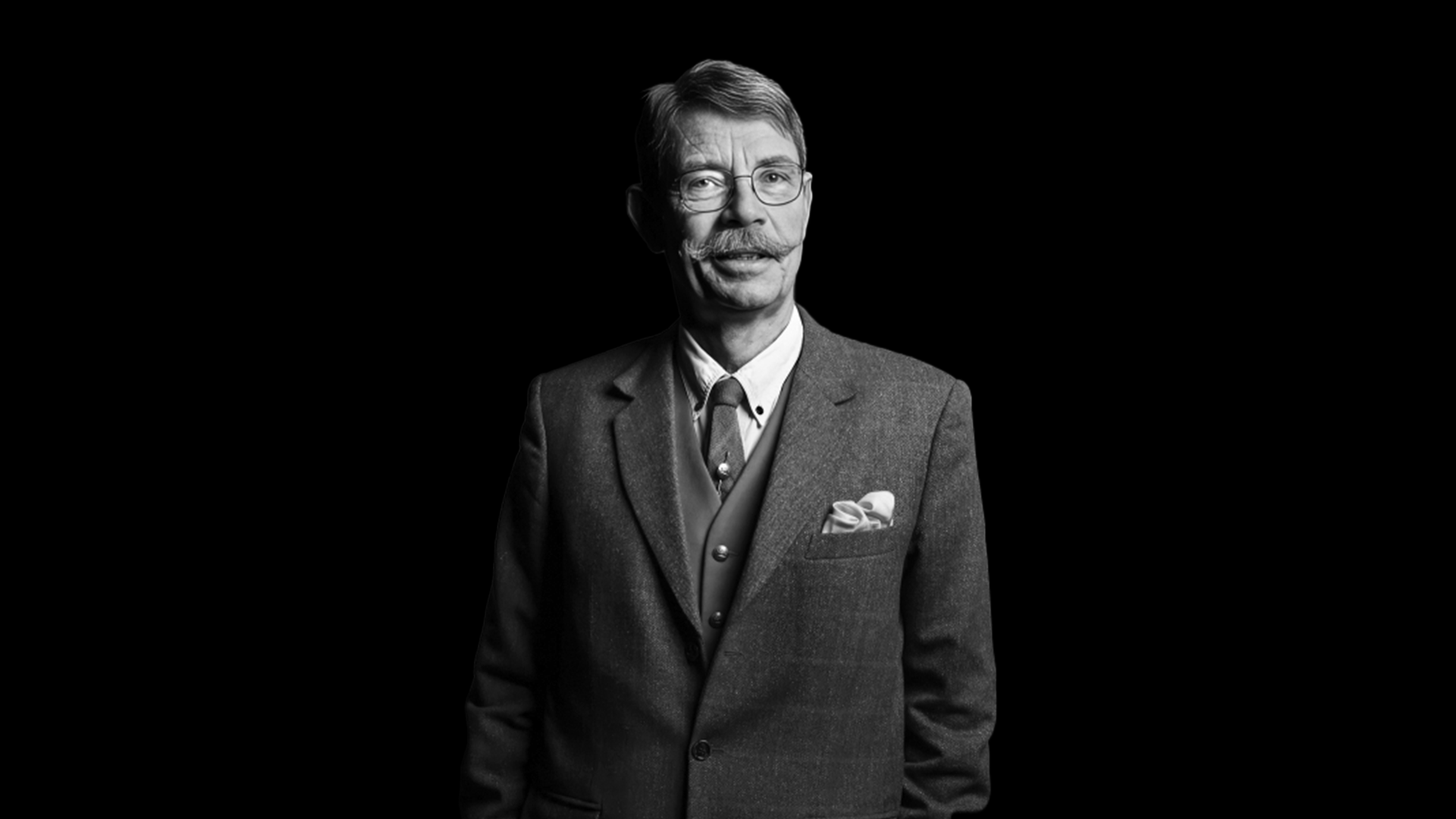C’est le berceau de la glorieuse dynastie almohade qui vient d’être frappé par un terrible tremblement de terre, et c’est son cœur, Tinmel, qui n’est plus aujourd’hui qu’un amas de décombres, sous lesquelles gisent encore nombre de malheureuses victimes prises dans leur sommeil.
C’est ici qu’Ibn Toumert fonda la dynastie almohade qui fit rayonner le Maroc d’Al-Andalus au fleuve Sénégal et de l’Atlantique à la Tripolitaine. C’est ici, dans le pays des Iguelouan (Glaoua), puis dans celui des Hazraga, aujourd’hui meurtris, qu’il rallia à lui Abou Hafs Omar, le chef le plus important de la confédération des Hintata.
En 1121, il choisit d’établir sa «capitale» à Tinmel dont le site permettait d’assurer la défense de la communauté à partir d’un vaste ribat, sorte de forteresse-monastère.
C’est là, dans ce cadre à la fois désolé et magnifique qu’Ibn Toumert réunit ses fidèles pour cultiver, entre ciel et terre, cet ascétisme mystique qui prépara les Almohades à la conquête des terres musulmanes d’Occident. En 1125, quand Ibn Toumert s’y installa, Tinmel n’était alors qu’une grosse bourgade de l’Atlas. Il y fit édifier de nouvelles maisons et de puissantes murailles et entama la construction d’une grande mosquée, remplacée ultérieurement par un nouveau lieu de culte, réalisé selon ses vœux. C’est tout cela qui vient d’être transformé en ruines.
Ces lieux difficiles d’accès, compliquant d’autant la tâche des secours, ont fasciné les voyageurs et ont été superbement décrits par des générations d’auteurs.
Au milieu du 12ème siècle, El Idrissi mentionne: «Le seul sentier qui conduit à Tinmel est étroit, escarpé et semblable à une échelle: une bête de somme ne saurait y monter qu’avec beaucoup de peine…»
En 1698 ou en 1699, Naciri es Slaoui, auteur du Kitab el-Istiqsa, décrit le lieu en termes saisissants:
«On ne peut arriver à Tinmel, jusqu’au lieu de repos des saints imams, que par une route formée de pièces de bois que l’on peut enlever au besoin et alors les chemins coupés ne laissent plus apercevoir aux guides que des abîmes sans fond…»
En 1924, ces deux grands amoureux du Maroc qu’étaient Henri Basset et Henri Terrasse purent écrire quant à eux que:
«La vallée du Nfis est le type même des grandes vallées montagnardes qui entaillent profondément le Haut Atlas au sud de Marrakech: canyon autant que vallée; étroit couloir tortueux enserré entre des pentes abruptes, dominé presque directement par des sommets qui sont parmi les plus hauts de la chaîne. Chaque berge est une muraille continue que brise rarement l’arrivée de quelque affluent descendu d’une semblable vallée. Ce couloir se poursuit, formidable, pendant des dizaines de kilomètres, entre des pentes toujours plus hautes. Tout au fond coule le torrent dont les eaux claires et rapides suffisent presque partout à couvrir l’espace étroit qui va de l’une à l’autre des gigantesques berges. L’été, quand les eaux sont basses, il peut servir de route, encore que difficile et resserrée à l’extrême; en hiver et au printemps, le fond de la vallée est tout à fait impraticable! Il ne reste plus alors qu’un chemin diabolique…».
Évariste Lévi-Provençal, enfin, nous a laissé en 1928 les lignes suivantes:
«Le sentier chevauche les berges vertigineuses, à travers la forêt rare de thuyas et de genévriers ou par les grandes pentes dénudées, montant et descendant pour s’accrocher à la moindre saillie de rocher; et par endroits, non pas seulement taillé au flanc de la montagne, mais véritablement bâti au-dessus d’à-pics de plusieurs centaines de mètres, étroite plate-forme reposant sur des poutres ou de larges pierres plantées de biais. Parfois, il plonge brusquement jusqu’au fond de la vallée pour passer sur l’autre berge, franchissant à gué le torrent -et l’on comprend que même ce chemin aérien, par les grandes crues d’hiver et de printemps, peut être coupé pendant bien des jours. Mais presque partout, il domine de très haut le gouffre où planent les aigles, et le Nfis tout au fond et, de loin en loin, étrange apparition dans cette solitude sauvage, un village… Car ces vallées sont habitées, autant du moins qu’elles peuvent l’être.
Partout où le fond s’élargit juste assez pour laisser une étroite bande de terre au-dessus du niveau qu’atteignent les hautes crues, les montagnards se sont installés. Avec une merveilleuse industrie, ils ont tiré parti de ces quelques arpents de sol cultivable; même ils les ont augmentés en créant de leurs mains des terrasses soutenues par des murs de pierres sèches; ils les ont transformés en jardins, les ont plantés de légumes, d’amandiers et de noyers. Ils les irriguent soigneusement (…). À proximité, mais hors de la terre irrigable, quelques maisons s’accrochent à la pente (…)».