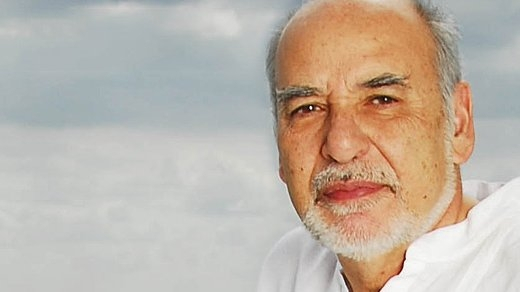Après Meursault, contre enquête (2014), on attendait le deuxième roman de Kamel Daoud. Zabor ou les psaumes (Actes Sud) paraît ces jours-ci. Je l’ai lu, je l’ai laissé reposer puis je l’ai relu. Livre complexe, mais quel beau livre!
C’est un cas! Une écriture très soignée, belle, poétique, inventive. L’histoire métaphorique est passionnante: célébration de l’écriture, force des mots, renouant en cela avec le pari de Shahrazade qui joue sa vie toutes les nuits et la sauve en racontant des histoires. Là, Kamel Daoud, prolonge la vie, sauve des mourants. Bel hommage à la littérature qui, on ne sait jamais, sauvera un jour le monde.
Mais quelque chose me gêne: les deux narrations. Les pages en italiques et entre parenthèses, voix intérieure et parfois remarques dites par son chien, arrivent comme un doublon. L’éditeur n’a pas fait son travail. J’ai fait l’expérience de ne lire que les pages en caractères normaux, puis de ne lire que les pages en italiques, et j’ai découvert deux romans, l’un en face de l’autre.
Cela dit, on ne peut pas passer à côté de ce roman –oral, très écrit–, rappelant les premiers textes de son compatriote Kateb Yacine (Nedjma). Il est complexe, parfois difficile à suivre, mais ça m’a rappelé, dans un autre ordre d’idée Boussole de Mathias Enard. C’est un livre sur la littérature, sa genèse, son importance, sa fonction, ses excès et aussi sa nécessité. Le pouvoir du narrateur est immense: repousser la mort par la littérature, rendre visite aux mourants et leur raconter des histoires, une façon unique, originale de réfuter la mort, lui demander de passer son chemin, d’aller voir ailleurs. Zabor a toujours baigné dans le monde des livres. Petit, il se baladait dans la campagne avec une série de livres miniatures suspendus à son cou.
Ce travail, hommage permanent à l’imaginaire, à l’écriture dans un pays où domine la tradition orale, est plus qu’un métier, c’est une vocation, un don qui va à l’encontre du champ déserté de la culture dans nos pays, où la lecture est devenue une pratique de plus en plus rare, où le religieux est en train d’envahir des domaines où il n’a rien à faire, où le manque de lucidité, de prise de conscience est devenu courant et banal. Kamel Daoud assume son rôle d’intellectuel appartenant à une société où le livre, en dehors du Livre, c’est-à-dire le Coran, a peu de place.
Le jour où le vieux grand-père agonise, on fait appel à Zabor et à son savoir-faire. Le vieux ne doit pas mourir. Mais ce vieux n’est pas n’importe qui. «Le vieillard était devenu une poignée de chair dans la main froissée du drap. Les cigognes de la mort étaient là, dans le gros nid invisible de sa tombe». Pendant que l’écrivain faisait ce qu’il fallait pour ranimer le vieux, la tante Hadjer parlait comme si elle devait élever une sorte de mur entre la vie et la mort qui avançait. Comme dit Zabor à propos de ce vieillard qui n’a pas fait que du bien dans sa longue vie «sa respiration et l’heure de sa mort dépendent de moi, de mon application et de ma constance dans la conjugaison des temps et la précision des adverbes. Il suffit que je cesse d’écrire pour qu’il meure ; tant que je suis penché sur mes cahiers, il survit». Pourtant il avait toutes les raisons du monde à hâter sa mort, car ce n’était pas un homme de bien.
C’est un pouvoir extraordinaire dont ont rêvé tous les puissants du monde. Faire échec à la mort, lui faire changer de chemin, la renvoyer à ses foyers, n’est-ce pas un désir permanent de ceux que l’or et le pouvoir ont rendus quasi immortels, mais qui meurent un jour comme tout le monde, comme le mendiant, le clochard ou le savant.
Zabor a tôt découvert que le monde est un livre. A propos d’une réflexion sur le mal (page 112), Kamel Daoud se montre humain, compatissant avec ceux qui méritent de mourir parce qu’ils ont fait tant de mal autour d’eux. Mais, généreux, il dit: «Le destin est un cahier comportant des fautes que l’on peut corriger».
Ce roman est assez particulier. Il arrive comme un appel au secours pour sauver la littérature et la lecture, à redonner au verbe écrit son rôle et son importance. Il est à contre-courant de ce monde où triomphent les imposteurs, les menteurs, les voyous, les gros ventres qui écrasent les autres avec arrogance et mépris. Ils sont l’essence et la puissance de la grande médiocrité. Kamel Daoud leur oppose le livre, le roman, le conte, une page d’écriture, une bibliothèque.
Il faut prendre le temps de lire lentement ce roman, plutôt récit, écrit merveilleusement malgré ces apartés en italique qui viennent interrompre le plaisir de la lecture.
Kamel Daoud est un excellent chroniqueur. C’est sans doute pour cela que Zabor ou les psaumes n’est pas tout à fait un roman, mais un regard, une belle et surprenante métaphore du monde qui tourne le dos à l’intelligence de tous les imaginaires.