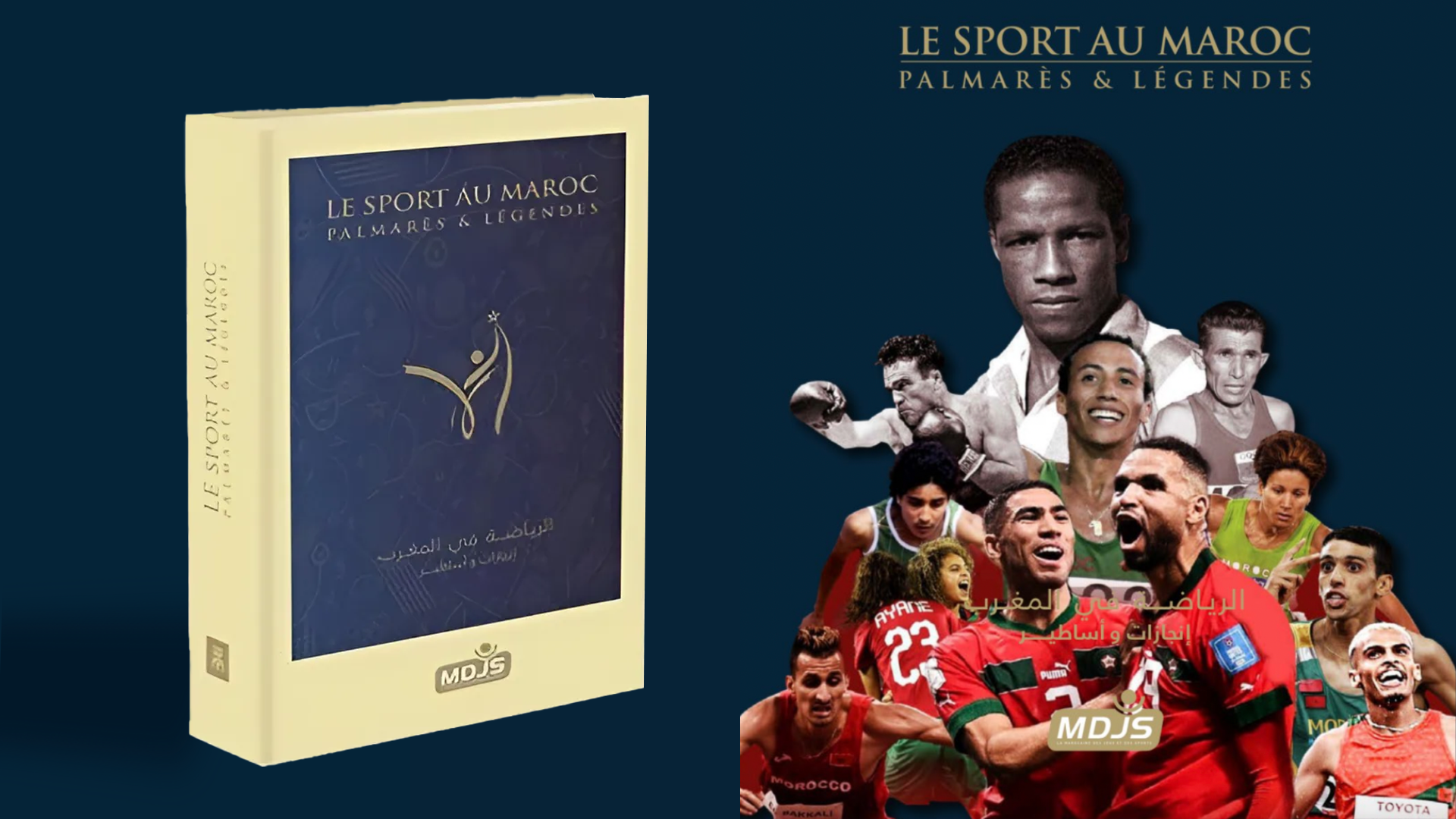Se lever, Préparer, Laver, Attendre, Dormir sans rêver, Se relever, Recommencer…
La répétition des tâches, des jours et des saisons a rongé peu à peu leur être intérieur. Leur vie n’est plus qu’une succession de devoirs accomplis sans joie, sans choix, dans un monde où elles ne décident plus rien. Combien d’entre elles n’avons-nous pas reconnues, ici, entre ces lignes? Dans la mère, la tante, la voisine, celle que l’on croise sans vraiment la voir. Celle qui parle beaucoup, qui rit parfois, mais dont le rire n’est qu’un apparat, une armure contre les larmes. Dans leurs yeux, il y a une poussière de tristesse indélébile, un reste de rêve éteint. Elles vivent pour les autres, se fatiguent pour eux, s’effacent pour qu’ils existent. Même leur sommeil n’est pas le leur: elles dorment pour se relever, non pour rêver.
Dans cette mécanique du quotidien, se terre la lente disparition de soi, le moment où le «je» cesse d’exister pour se fondre dans un rôle de mère, d’épouse, de ménagère. La peur s’installe, subtile mais tenace, la peur de la maladie, la peur de la vieillesse, la peur de ne plus plaire, la peur d’être remplacée. Cette peur, transmise dès l’enfance, signe curieusement un pacte machiavélique avec la dépendance et ses corollaires.
Les femmes vivent dans cette tension constante, persuadées qu’il ne faut pas se plaindre, qu’il faut relativiser parce que d’autres vivent «pire». Elles nivellent leur douleur par le bas, comme si la comparaison atténuait l’injustice. Cette attitude, si commune, est aussi le fruit d’une norme sociale qui justifie la résignation et rend acceptable l’inacceptable.
Les femmes savent qu’elles s’éteignent, mais elles continuent, parce qu’on leur a inculqué que le sacrifice est une vertu, que c’est «comme ça», comme je l’écrivais dans mon ouvrage Par les liens forcés du mariage.
Ce «comme ça» qui clôt toute révolte avant même qu’elle ne naisse,
Ce «comme ça» transmis de mère en fille comme une consigne de survie travestie en sagesse, Ce «comme ça» qui justifie l’injustice et anesthésie la douleur, Ce «comme ça» qui rend acceptable l’effacement, Ce «comme ça» qui empêche d’imaginer autrement, Ce «comme ça» qui enferme les femmes dans la continuité des gestes et des silences, Ce «comme ça» qui les étouffe dans la répétition des renoncements, Ce «comme ça» qui tue le rêve...
Ce «comme ça» que beaucoup de femmes récitent comme une litanie pour ne pas perdre l’équilibre.
Ce «comme ça» qu’il faut démolir en hurlant qu’il n’est ni une fatalité ni un mode de vie. Il est une invention sociale, le Frankenstein du patriarcat, un mur invisible contre lequel se brisent les désirs et les possibles.
Aujourd’hui, ma mère, qui vit depuis soixante ans en contexte d’immigration, est atteinte de démence. Et dans son silence, dans ses gestes devenus lents, j’entends l’écho d’une vie entière passée à servir, à s’oublier, à s’adapter. J’ai voulu relier son destin à celui de tant d’autres femmes que l’exil a abîmées. Celles qui ont porté leur famille à bout de bras, souvent dans la solitude, dans l’incompréhension. Celles qui ont vieilli loin des leurs, dans des pays qu’elles ont appris à aimer.
En cela, les films de Karima Saïdi (Dans la maison) et de Samira El Mouzghibati (Les Miennes) m’inspirent profondément. Ces deux œuvres sont pionnières dans la manière dont elles abordent les parcours féminins de femmes marocaines en Belgique. Elles brisent le silence et mettent des images, des voix et des visages sur des existences longtemps reléguées dans l’ombre.
Dans la maison (2020), Karima Saïdi nous livre un documentaire d’une tendresse bouleversante. La réalisatrice y filme sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer, dans un huis clos empreint de douceur et de douleur. C’est une conversation entre deux générations, entre mémoire et oubli, entre une fille qui tente de comprendre et une mère qui s’éloigne de son présent et se rapproche de son passé. À travers la maladie, Karima Saïdi a revisité l’histoire de l’immigration, la condition féminine et la transmission vacillante entre les mères et leurs filles. Ce film n’est pas seulement un portrait intime mais un geste de réparation qui nous réconcilie avec nos mères et leur fait place et dignité dans la mémoire.
Les Miennes (2023) de Samira El Mouzghibati s’inscrit dans la même lignée, avec une force différente mais tout aussi essentielle. Samira, caméra au poing, explore l’héritage de la migration et de la maternité à travers les liens de trois générations de femmes, les «siennes». Sans tabou, avec humour, parfois gravité, la réalisatrice y interroge les silences familiaux, les blessures héritées, les injonctions de la loyauté et du devoir. Elle a donné à voir la fatigue des mères, le poids de la mémoire, la difficulté d’exister entre deux mondes. Son regard mêle pudeur et lucidité, et donne à voir des femmes qui, tout en portant les traces du déracinement, cherchent, chacune à leur manière, au gré des générations, leur propre voie vers la liberté ou dans la résignation.
Ces deux films, chacun à leur manière, ont ouvert une brèche dans le paysage cinématographique belge. Ils portent la voix de celles qui ne l’avaient pas, aux femmes de la première génération d’immigration marocaine dont la vie s’est souvent confondue avec le silence, l’invisibilité dans l’ombre du mari qu’elles avaient «suivi». Ils inspirent ce texte, car ils rappellent que derrière chaque visage de femme, il y a une histoire faite d’exil, de courage, de renoncements et d’amour. Et qu’il est temps, plus que jamais, de leur rendre ce que l’histoire leur a pris: la parole, la mémoire, et le droit au rêve.